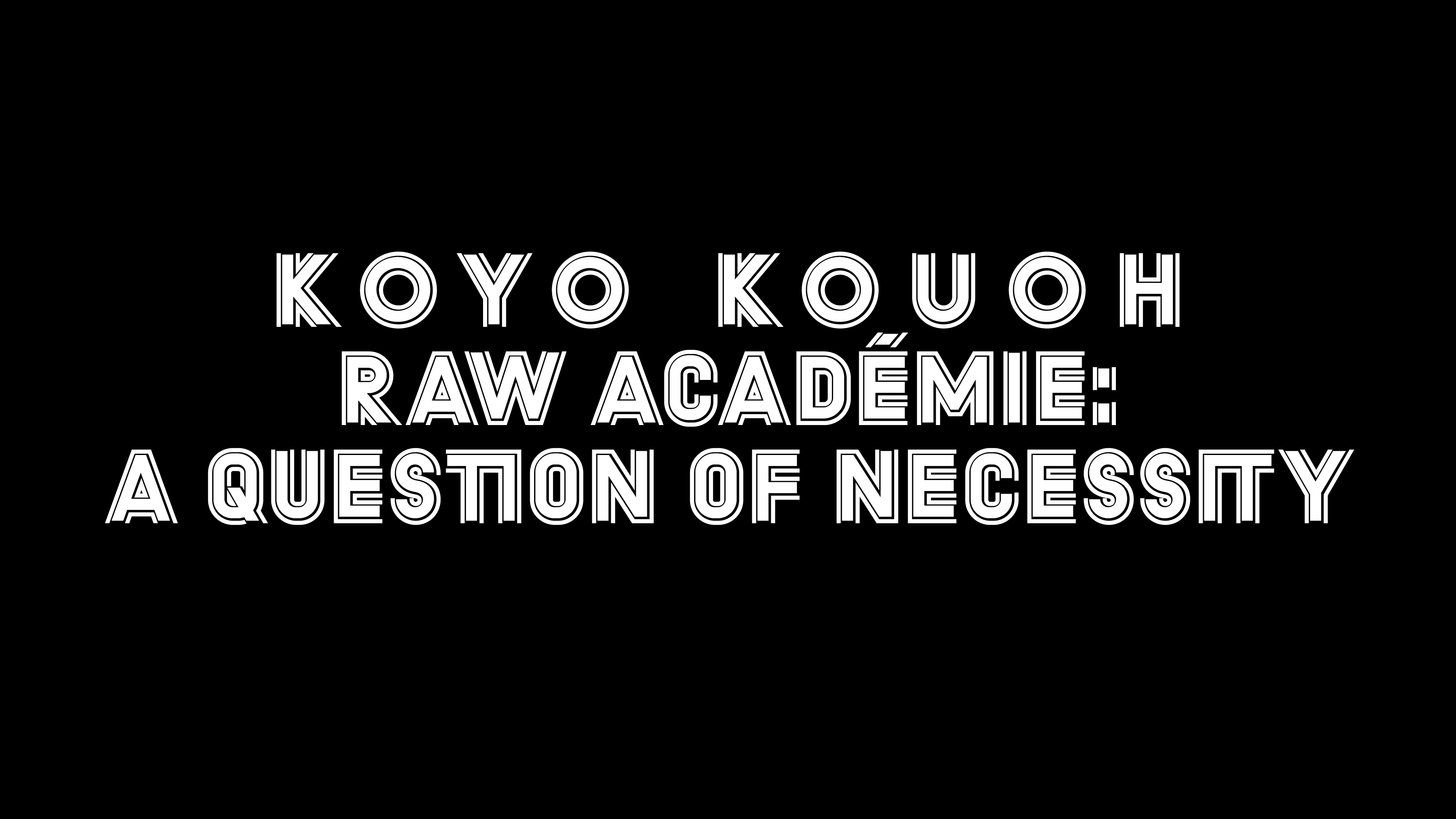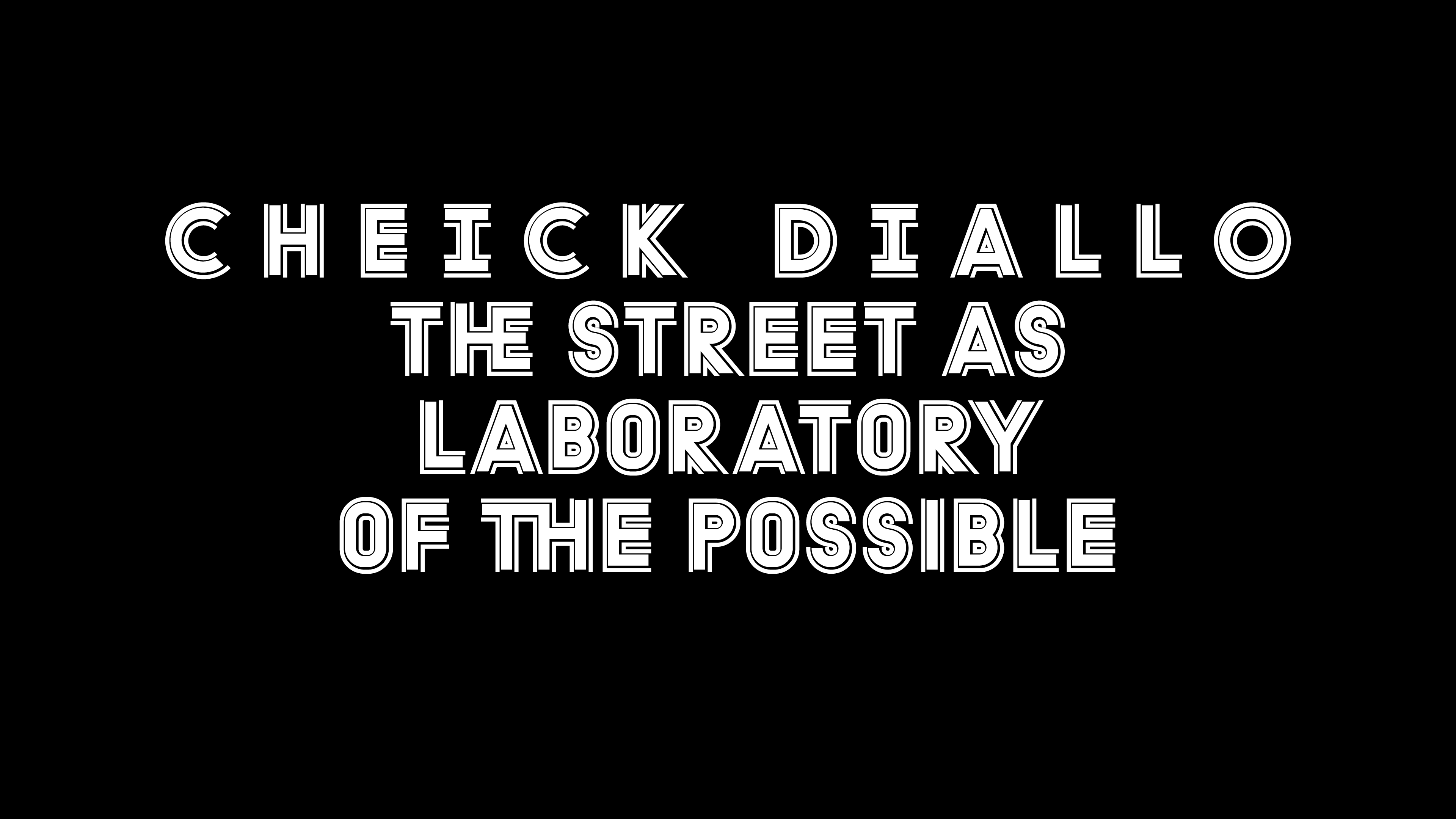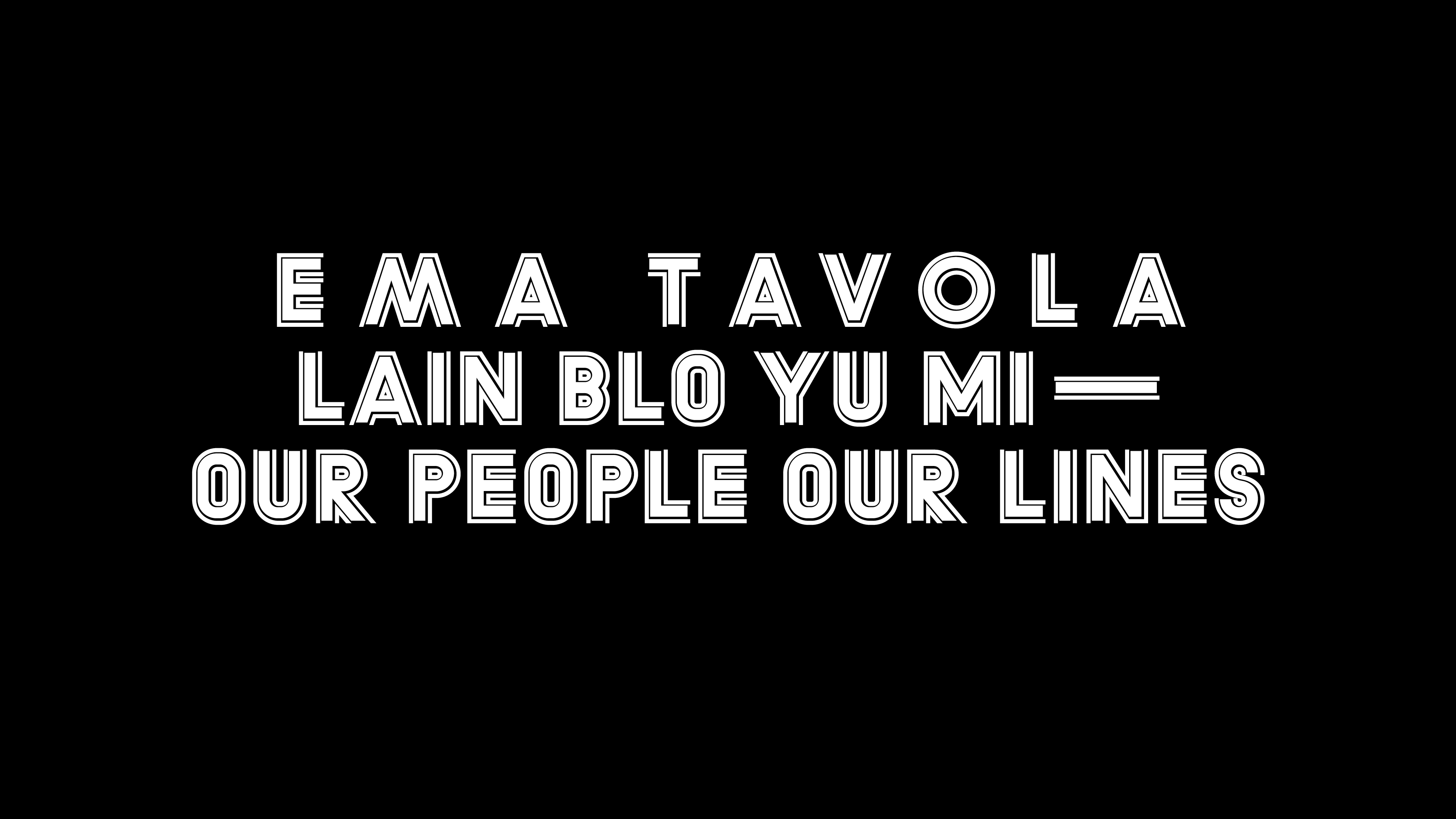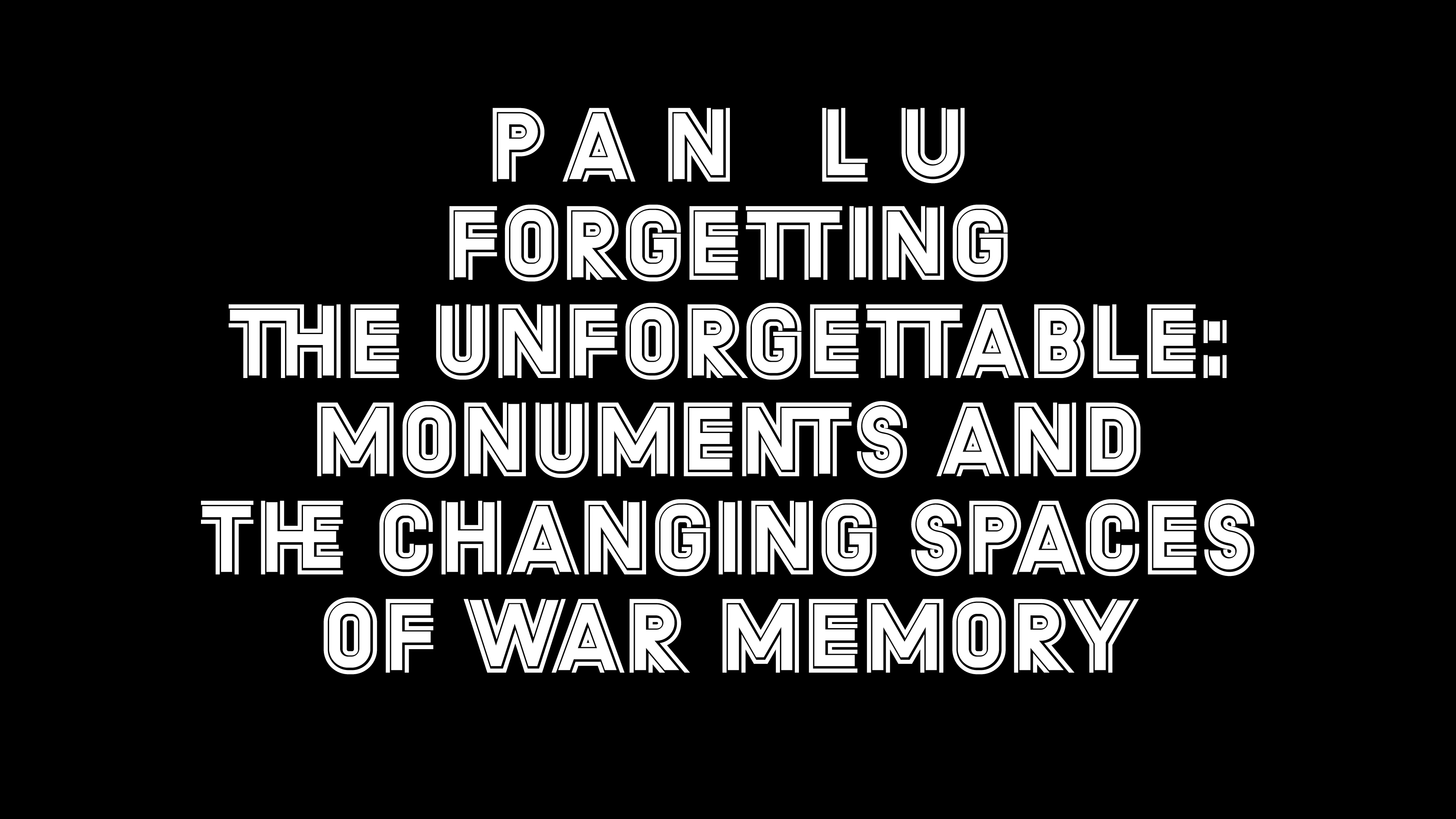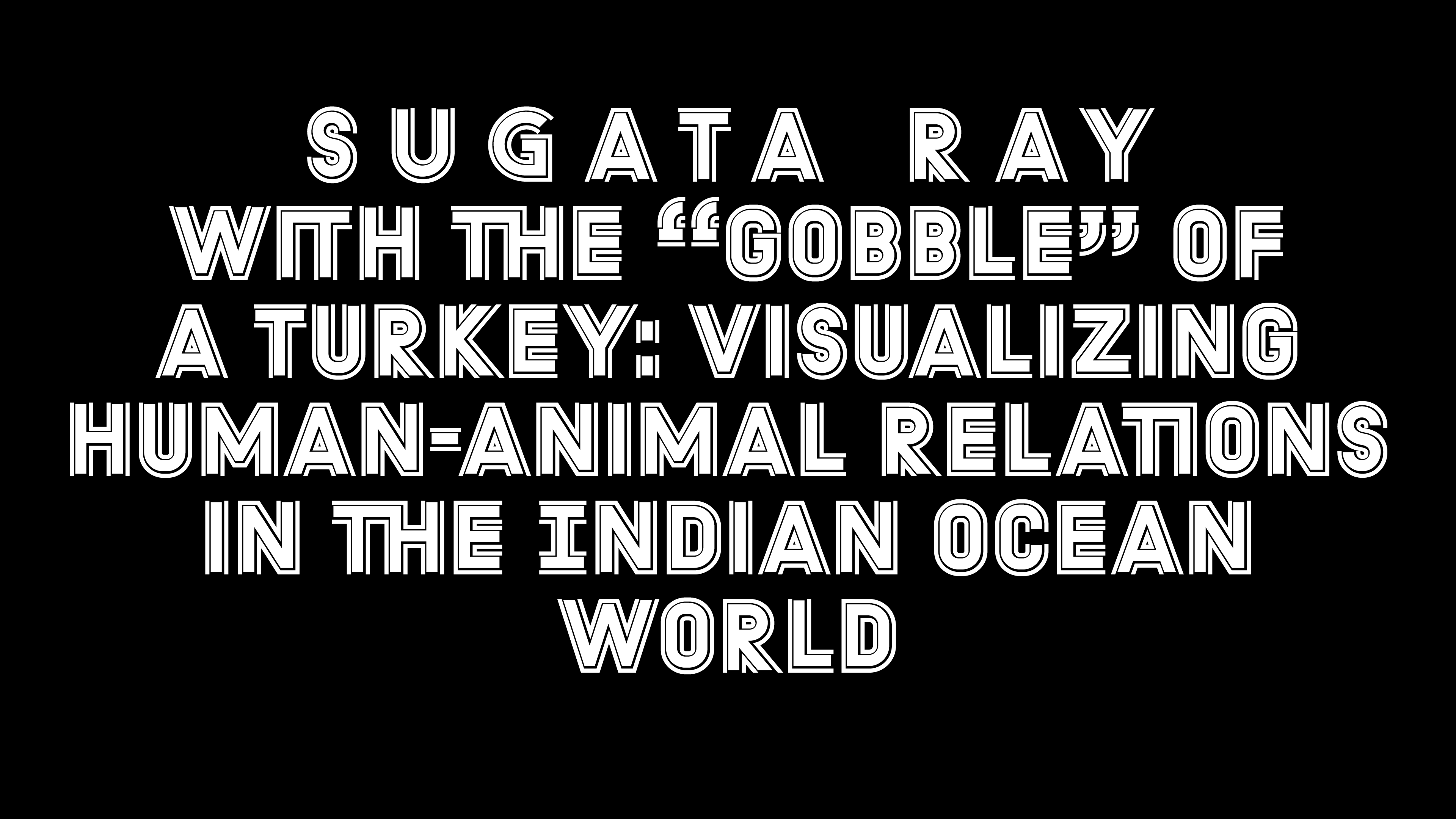L’Academie des Beaux-Arts de Kinshasa, une institution artistique pluridisciplinaire et transversale
Triangles Tournoyants : Départ pour une École de Design, est un projet de S A V V Y Contemporary – The Laboratory of Form-Ideas. En 2019, à l’occasion du centenaire du Bauhaus, nous avons commencé à contester et à agir contre les structures de pouvoir néocoloniales inhérentes aux pratiques, à la théorie et à l’enseignement du design. Le projet s’est métamorphosé, s’est multiplié et a tissé sa toile entre Dessau, Kinshasa, Berlin et Hong Kong.
Avec cette plateforme de publication, nous souhaitons partager certains fragments des complexités qui relient les questions du projet entre-elles. Ces “nœuds complexes” remettent en cause et mettent au jour les structures de pouvoir présentes, et pointent du doigt les failles et les perspectives possibles des normes, des épistémologies et des futures. Ce faisant, nous espérons contribuer aux conversations actuelles sur la façon de penser, de faire, d’apprendre et de désapprendre ce qui est communément appelé la pratique du “design”. Plutôt que d’être une conclusion à ces efforts, ce site web ouvre la voie à bien plus de questionnements et forme-idées.
Vous trouverez des informations détaillées sur le concept et le programme du projet ici
À propos des technologies (numériques) et de la colonialité
Une conversation avec Aouefa AmoussouviElsa Westreicher: Bonjour Aouefa ! Nous sommes très heureuses de pouvoir nous réunir avec vous au-jourd’hui pour parler de votre atelier dans le cadre du chapitre berlinois de Triangles Trounoyants. Pourriez-vous nous expliquer brièvement en quoi consistait votre atelier ?
Aouefa Amoussouvi: Oui, bien sûr. Il s’agissait d’un atelier de deux jours intitulé À propos des technologies (numériques) et de la colonialité. Au cours de la première journée, nous avons parlé de l’histoire des technologies numériques, de ce qu’elles sont, des différents types de technologies existantes, de la manière dont nous pouvons les utiliser, de leur développement et de leur sur-présence de nos jours. Nous avons discuté des opportunités ainsi que des défis éthiques qu’elles créent dans le contexte de la décolo-nisation et du féminisme. Puis, le deuxième jour, j’ai supprimé le mot « numérique » dans le titre pour me concentrer sur la technologie de manière plus générale. Je me suis intéressée aux méthodes ou pratiques anciennes, en particulier celles que l’Occident ne reconnaît pas vraiment comme des technologies – peut-être parce qu’il n’existe pas encore d’outils pour mesurer leur efficacité.
J’ai présenté deux exemples : le cacao brute, une plante médicinale et la méditation. Le cacao brut était consommé par les Mayas et les Aztèques lors des cérémonies. J’ai guidé le groupe dans la préparation d’une boisson à base de cette plante. Nous l’avons bue ensemble avant de méditer. La méditation est pratiquée en Asie depuis plus de 4000 ans. De nos jours, l’Occident s’intéresse de plus en plus à cette pratique, car des outils permettent désormais de mesurer ses effets dans le cerveau. Ainsi les scientifiques se sont rendus compte qu’en effet, la méditation affecte cet organe.
Elsa Westreicher: Je me souviens que beaucoup de participants ont partagé leurs expériences par la suite et étaient très enthousiasmés par ce qu’ils avaient appris grâce à cela. Je m’interroge sur deux aspects que vous avez abordés. L’un d’entre eux étant la catégorie de la technologie elle-même. Qui ou quoi est considéré comme technologie ? Pourriez-vous développer un peu plus ce point ? L’autre question concerne davantage le « numérique » – voudriez-vous dire quelque chose sur les philosophies, ou peut-être plutôt les différentes conceptions de la façon de se rapporter au monde, que le code bi-naire illustre ?
Aouefa Amoussouvi: J’ai trouvé intéressant de commencer par les définitions de ces termes. Qu’est-ce qu’une « techno-logie » et qu’est-ce qu’une « technologie numérique » ? Tout le monde parle des technologies numé-riques aujourd’hui. Nous comprenons plus ou moins ce que cela signifie, mais nous n’en sommes souvent pas totalement sûrs. J’ai donc cherché les définitions. Technologie vient du grec ancien et signifie « science de l’artisanat ». Il s’agit d’un outil, d’un matériau ou d’un savoir développé pour ré-soudre un problème ou pour développer les capacités humaines. Une technologie n’a donc pas be-soin d’être numérique. Par exemple : les chaussures sont une technologie car elles nous permet-tent de marcher sans nous blesser les pieds. Une recette pour créer du ciment ou de la forge sont également des technologies. Ou alors l’agriculture qui a elle-même rassemble de nombreuses technologies. Examinons maintenant le mot « technologie numérique ». Numérique, en anglais « di-gital », vient du mot latin « digitus », qui signifie doigt. Les doigts et nos mains ont été les premiers outils pour compter. Quand nous apprenons aux enfants à compter, nous leur disons d’utiliser leurs doigts pour les aider. Une technologie numérique est donc une technologie basée sur les chiffres, sur les doigts, et elle implique la conversion de l’information en un format numérique, c’est-à-dire un format numérique composé de uns et de zéros, pour le stockage et le traitement des données. On peut penser à nos appareils photo numériques, ordinateurs, smartphones, l’internet, l’impression 3D... Cela répond-il à votre question ?
Elsa Westreicher: Oui, en grande partie. Il s’agissait aussi de savoir qui ou quoi est considéré comme appartenant à la technologie ou à la technologie numérique. Vous y avez déjà répondu en élargissant ces définitions. Je suppose que la question est venue de la volonté de réfléchir à cette interprétation étroite, afin de l’élargir. Pour le reste de la question nous aurons peut-être le temps d’élaborer plus tard.
Arlette-Louise Ndakoze: Passons à la deuxième question, simplement parce que vous avez mentionné les smartphones. Il semble qu’aujourd’hui les sociétés industrialisées soient très conditionnées par la perception numé-rique des choses. Nous organisons nos journées, nos transports ou repas, nos livraisons, nos vê-tements, nos meubles, nos voyages autour d’appareils numériques tels que les smartphones ou les iPads, et les nombreuses applications qui les entourent. Qualifieriez-vous cette intelligence d’artificielle ? Et voyez-vous une tendance des sociétés à devenir artificielles, en entendant par là que les humains sont remplacés par la technologie ?
Aouefa Amoussouvi: C’est une question très intéressante. Quand je commence à parler de ce sujet de la technologie numérique, j’aime rappeler aux gens qu’une technologie numérique est un outil et qu’un outil est gé-néralement neutre. Ce n’est ni bon ni mauvais. Mais la façon dont vous l’utilisez apporte une plus value ou non. Pensons à un couteau. Vous pouvez préparer un repas avec cet outil ou couper quelque chose en petits morceaux afin de le partager au sein d’un groupe. Mais avec le même cou-teau, vous pouvez aussi commettre un meurtre.
Les technologies numériques ne sont pas mauvaises en tant que telles. En ce moment précis, nous utilisons Skype pour avoir cette discussion. Skype et tous les autres outils de communication nu-mérique permettent, par exemple, à de nombreux immigrants de parler, même de voir leurs amis et leur famille. Ils ne peuvent pas se rendre chez eux, mais ces technologies numériques leur permet-tent d’entretenir des contacts et des relations qui ne seraient pas si faciles à maintenir avec des technologies plus anciennes comme le téléphone ou les lettres. Du moins pas avec la même régu-larité et le même format. Les technologies numériques permettent l’éducation, l’auto-organisation, la construction de communautés...
D’autre part, ces technologies aident la société capitaliste à consommer des objets et des êtres humains ; à acheter toujours plus et plus vite. Au lieu de faire les courses dans un magasin et d’avoir une interaction, même brève, avec un autre être humain, nous achetons les produits sur internet et restons simplement isolés dans nos maisons... tout en étant en ligne sur les réseaux so-ciaux. Aussi, nous oublions souvent que la production et l’élimination de nos appareils sont directe-ment liées aux conditions de travail abusives et aux catastrophes environnementales.
Un autre exemple est l’utilisation de pseudonymes sur internet. Nous nous sentons anonymes et protégés derrière nos ordinateurs, derrière nos smartphones. La technologie ne nous donne pas vraiment le sentiment d’être attachés et connectés aux autres et cela ouvre la porte aux discours haineux. Je suis assez positive sur les technologies numériques parce que je vois beaucoup de possibilités, mais, bien sûr, je vois aussi de sérieux problèmes. Vue qu’elles se développent si rapi-dement, le défi est grand pour les personnes et la société de les comprendre et de créer des ré-glementations légales pour protéger les utilisateurs sans pour autant restreindre la liberté d’expression ou tout autre droit. Dans différents pays ça se développe maintenant, mais lentement. Les réglementations sont un moyen de faire face à ces situations et d’éviter que ces technologies maintiennent ou même renforcent le capitalisme, le patriarcat ou le racisme.
Arlette-Louise Ndakoze: Intéressant. Je voudrais juste avoir votre avis sur le terme d’intelligence artificielle.
Aouefa Amoussouvi: L’intelligence artificielle... Vue sous l’angle technique, l’intelligence artificielle est un algorithme. Il s’agit donc d’un code, d’un script qui est alimenté par des informations et qui simulera de nouvelles informations. Cela signifie que les intelligences artificielles sont très dépendantes de ce qui leur est donné comme information initiale.
Il y a là une histoire intéressante à raconter. Microsoft a développé un chat-bot basé sur l’intelligence artificielle et a ouvert un compte Twitter pour ce robot. Le chat-bot apprenait à partir de conversations dominants les discours de la génération du millénaire (« millenials ») et a commencé à écrire des commentaires misogynes, racistes et antisémites. Il a donc dû être fermé au bout de 24 heures seulement. Il s’agit donc, là encore, d’un produit fabriqué par des êtres humains qui reste dépendant des personnes qui le produisent et l’utilisent.
Arlette-Louise Ndakoze: Mais diriez-vous que c’est artificiel, si cela vient des humains, ou est-ce juste la technique qui l’est ? Quel est votre rapport avec cette technique ? Dites-vous aussi intelligence artificielle ? D’après votre définition, y a-t-il un terme que nous pouvons utiliser pour cela ?
Aouefa Amoussouvi: Je dirais qu’elle est artificielle parce qu’il ne s’agit pas d’une intelligence biologique. Si j’essayais de trouver un autre mot... Y a-t-il un autre mot que vous préférez utiliser lorsque vous pensez à ces technologies ?
Arlette-Louise Ndakoze: Peut-être y parviendrons-nous. Au sein du projet Triangles Tournoyants de SAVVY, nous avons ré-fléchi aussi sur les outils. Lorsque vous avez parlé des outils comme de n’importe quel outil que nous pouvons utiliser tous les jours afin que notre vie puisse être adaptée à quelque chose qui la facilite ou nous rapproche davantage les uns des autres, cela a aussi clarifié nos réflexions. C’est là que je pense le design a germé. Je me demande jusqu’où nous sommes allés dans cette histoire d’outils. Parfois aussi, certains noms nous sont donnés, bien qu’ils ne correspondent pas toujours à la réalité. C’est là que je voulais aller. Ce genre de domination qui vient de l’extérieur nous disant que nous ne sommes plus humains ou que nous n’avons plus de relations les uns avec les autres parce que nous sommes maintenant remplacés. Que nous sommes remplacés par un système sur lequel nous n’avons aucun contrôle et auquel nous devrions nous habituer. Tout cela est encore un peu plus amplifié par un autre discours contemporain, celui de l’humain et le non-humain, et l’agentivité. Vous savez, au lieu de dire la nature, les gens disent le non-humain comme si l’humain était une référence pour tout dans ce monde. Donc, j’étais juste curieuse de connaître votre point de vue à ce sujet en tant que biophysicienne.
Aouefa Amoussouvi: Lorsque j’utilise le mot « intelligence artificielle », je fais référence à cette technologie qui peut déve-lopper de nouvelles informations à partir des informations initiales. Je suis d’accord sur le fait que la façon dont nous nommons les choses a de grandes implications et que l’égocentrisme des humains est problématique. En facilitant et justifiant l’exploitation ou la destruction de la nature, par exemple. Le problème plus profond est qu’en raison de leur vitesse et de leur amplitude, les technologies nu-mériques amplifient tous les défauts de la société actuelle.
Arlette-Louise Ndakoze: Oui. Passons à la question suivante. Vous avez déjà mentionné la méditation que vous avez faite. Pouvez-vous revenir un peu plus sur cela et expliquer comment c’est lié au mode numérique ?
Aouefa Amoussouvi: Comme je l’ai dit au début, je voulais aborder la notion de technologie au sens large ainsi que la question de savoir qui décide de ce qu’on peut appeler technologie ou non. Il me semble que beau-coup de technologies généralement non occidentales ou liées aux femmes ne sont pas reconnues comme telles par l’Occident, parce qu’elles sont considérées comme trop abstraites ou ésotériques. Un exemple est la méditation, qui est une technique très ancienne. Les gens méditaient déjà il y a plus de 4000 ans. Aujourd’hui, grâce aux progrès de la science, on a pu mesurer que la méditation affecte le cerveau et a même un effet « anti-âge » pour les personnes qui la pratiquent pendant une longue durée. Les participant·e·s à l’atelier venaient de différentes parties du monde, de différentes cultures et travaillaient dans différentes disciplines. Je ne voulais pas seulement les faire réfléchir aux nouvelles technologies qui viennent de l’Occident et qui peuvent peut-être leur faciliter la vie. Je voulais qu’ils réfléchissent aux outils présents dans leurs cultures, mais considérés uniquement comme des traditions folkloriques et non comme des technologies puissantes. Il est intéressant de constater qu’il existe aujourd’hui une sorte de boucle. Je veux dire par cela qu’il existe aujourd’hui de nombreuses technologies numériques qui confirment l’efficacité de la méditation et permettent aux gens de méditer. La pratique de la méditation et/ou de la pleine conscience peut également ai-der à employer et à développer les technologies numériques de manière éthique.
Arlette-Louise Ndakoze: Je ne savais pas que la méditation pouvait être considérée comme une technologie, ou un outil. A quoi cela ressemblait-il ? Les gens étaient-ils assis en fermant les yeux ou avaient-ils quelque chose dans les mains ?Aouefa Amoussouvi: Il existe des façons très différentes de faire de la méditation. Je pense que la plupart du temps, les gens ont une image en eux de quelqu’un assis avec les jambes croisées et les yeux fermés, qui reste silencieux et statique. C’est une façon de faire, mais il y en a beaucoup d’autres. Pendant l’atelier, j’ai profité du jardin, c’était l’été et il faisait vraiment beau. Nous avons fait une méditation ambulante, où l’idée était de marcher très lentement et de façon consciente, de se concentrer sur la plante des pieds. Pour chaque pas nous nous sommes concentrés sur le contact des différentes parties des pieds avec le sol. Nous avons donc marché comme ça pendant une vingtaine de mi-nutes. Nous sommes ensuite retournés à l’intérieur du bâtiment pour être dans un espace tranquille, où nous avons fait vingt minutes de méditation en fredonnant des vibrations avec nos bouches fer-mées. Ensuite, nous avons fait vingt minutes de méditation silencieuse. J’ai trouvé important de présenter quelques méditations actives et passives pour montrer que les gens n’ont pas à se battre pour rester silencieux si ils veulent exercer leur attentivité. Vous pouvez la pratiquer de différentes manières. Mais ce qui est le plus important dans la méditation, c’est d’être conscient, de ne pas ju-ger ce qui se passe autour de soi et de rester détendu. Cela peut se faire en étant assis et statique, mais cela peut aussi se faire en marchant ou en faisant autre chose.
Arlette-Louise Ndakoze: Je vous remercie.
Elsa Westreicher: Ensuite, nous pourrions peut-être passer à la dernière question, qui va dans une direction différente. Actuellement, d’énormes quantités de données sont stockées par des entreprises monopolistiques, des sites web et des applications que nous utilisons. Ces activités de stockage frénétiques me rap-pellent parfois l’engouement ethnographique qui a rempli et qui remplit encore les musées en Occi-dent. Ni les musées, ni les sociétés de technologie n’ont le bon sens d’interpréter ou de faire quoi que ce soit avec les objets qu’ils stockent. On pourrait dire heureusement, mais nous savons tous que dans les deux cas, ces choses ne sont pas entre de bonnes mains. Dans le cas des entre-prises technologiques, les ordinateurs et les technologies de stockage contemporaines, ils ne sont pas encore assez avancés pour permettre une analyse approfondie. Mais je me demande souvent ce qui pourrait se passer si cela devait un jour être le cas. Que voyez-vous lorsque vous considé-rez cela comme l’un des possibles futurs ?
Aouefa Amoussouvi: Oui, cette folie des données. De nos jours, cela soulève de plus en plus de questions. Il y a tant de données stockées à notre sujet. Données relatives aux sites web que nous visitons, à la fréquence de nos visites, aux personnes que nous connaissons et avec lesquelles nous communiquons, à l’endroit où nous nous trouvons. Ce sont des données sur ce que nous aimons, nos habitudes, notre personnalité. Elles peuvent être très personnelles et très intimes. Heureusement, les gens sont aujourd’hui de plus en plus intéressés par ce qui se passe et posent des questions. Mais nous avons besoin de plus de transparence et de réglementation pour protéger les utilisateurs.
La plupart de ces données sont vendues à des fins publicitaires, mais elles peuvent aussi être utili-sées de manière très dangereuse. Je pense aux gouvernements, et aimerais prendre l’exemple de la Chine, même si des pratiques similaires sont utilisées également dans d’autres pays, l’Occident inclus, bien que moins évidentes parfois. Le gouvernement chinois, utilise la cyber-surveillance pour collecter des données sur ses citoyens et contrôler la population. Si vous faites l’éloge du gouvernement sur les réseaux sociaux, vous recevez des points positifs. Si vous ne le faites pas, vous obtenez des points de citoyen négatifs. Le gouvernement chinois veut encourager et récom-penser les « bons » comportements, ce qui facilite la vie de ces citoyens en retour. Par exemple, les « bons » citoyens payent moins ou pas de frais pour l’école pour leurs enfants, ou pour les transports publics. Les « mauvais » citoyens, ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement, sont sanctionnés et doivent payer plus d’argent pour des produits de la vie quotidienne ou, dans des cas extrêmes, peuvent être envoyés en prison.
Je répète, il existe également des utilisations positives de données stockées. Je pense au domaine de la médecine numérique, aux diagnostics et traitements plus personnalisés. À plus grande échelle, si nous collectons beaucoup de données sur la santé des gens, nous pouvons également prendre des décisions plus précises en matière de santé publique. Que pouvons-nous faire pour nous as-surer que nos données sont bien utilisées? Cela reste une question très délicate.
Elsa Westreicher: Afin d’approfondir cette question, je voudrais la relier à l’enquête précédente sur le code binaire et son système sous-jacent de pensée et d’existence dans le monde. Sachant que les technologies numériques électroniques sont basées sur l’opposition binaire entre zéro et un, entre l’être et le non-être, qui se reflète dans les flux d’énergie électrique qui sont soit coupés soit autorisés, je m’interroge maintenant sur une autre binarité que vous mentionnez, qui serait celui entre le bien et le mal. La question de savoir qui décide réellement de ce qui est bon ou mauvais est ici implicite. Mais je me demande aussi s’il est utile d’appréhender le monde selon une logique binaire. Je conti-nue à me demander si cette logique binaire des machines électroniques que nous utilisons n’amplifie pas, d’une manière ou d’une autre, ce mode de pensée binaire.
Aouefa Amoussouvi: Je pense que vous avez déjà assez bien décrit la situation. Les humains aiment avoir cette logique ou ce jugement binaire, mettre des personnes ou des objets dans des cases, les valoriser ou non, les étiqueter comme bons ou mauvais, par exemple. Beaucoup de gens se rendent compte qu’il y a beaucoup de potentiel et d’argent à gagner en collectant des données. La question de l’utilisation des données est liée à la personne qui analyse, interprète ces données et prend des décisions sur la base de celles-ci une fois qu’elles ont été analysées.
Il existe aujourd’hui un dangereux fossé entre les producteurs et les utilisateurs des technologies numériques. Nous avons besoin de plus de diversité dans la phase de production. J’entends par là plus de femmes et de personnes de couleur dans la branche informatique, qui créent ces technolo-gies et interprètent les données. En même temps, nous devons, en tant qu’individus, nous informer sur les médias, l’internet et les risques liés aux technologies numériques. Enfin, nous devons nous rappeler que ce sont les humains qui fabriquent ces outils et non l’inverse.
Notre point de départ était d’ignorer le Bauhaus
Une conversation avec Cosmin Costinas (Directeur Executif/Commissionaire à Para Site) et Anqi Li (Commissionaire du Programme Publique et Educatif à Para Site)Arlette Ndakoze: Pour notre première question, nous nous tournons donc vers toi, Cosmin. Qu’est ce que cela signifie pour Para Site d’avoir entrepris le projet de Triangles Tournoyants à Kinshasa et à Hong Kong avec nous durant cette année?
Cosmin Costinas: Cette collaboration comporte plusieurs aspects. Elle est liée à notre désir de nous engager plus substantiellement avec vous, avec S A V V Y. La collaboration institutionnelle en elle-même était donc très importante pour nous. Parce que nous croyons fermement que les institutions qui partagent une grande partie de leurs programmes et les même responsabilités, devraient être solidaires dans un processus de travail en commun. Deuxièmement, mais pas dans un ordre particulier, je pense qu’il était très important pour nous de comprendre les différents modes d’éducation – la question de l’éducation est une question permanente, bien sûr – mais il est toujours très important pour nous d’essayer de comprendre comment les institutions de notre genre peuvent poser cette question et ce problème. Comment, du point de vue d’une plateforme critique et d’un enseignement institutionnel non-académique, cela peut-il conduire à un résultat éducatif pour le public avec lequel nous nous engageons? Que ce soit le grand public ou les petits groupes. Tant à Hong Kong qu’à Kinshasa, il y avait cette sorte de double couche. Il était très important de voir cela se produire. Prenant en compte le spectre pesant du Bauhaus, qui est encore une tradition très puissante et dominante, c’était très important donc. Et troisièmement, c’était aussi simplement de pouvoir collaborer avec des collègues de Kinshasa. Cela était aussi très bien pour nous. Nous sommes très engagés dans le processus de travail avec différents réseaux et différentes zones géographiques. C’est quelque chose que nous faisons depuis de nombreuses années maintenant. Cela faisait donc partie intégrante de la manière dont nous voyons notre travail et notre universalité institutionnelle, pour ainsi dire. Nous avons rencontrer des gens incroyables cette année. Dans les deux cas. Je pense donc qu’en fin de compte, c’est aussi une incroyable production intellectuelle qui s’est produite le long de Triangles Tournoyants.
Arlette Ndakoze: Je voudrais juste si c’est ok, rebondir sur l’aspect éducatif. La conférence dans son ensemble a été extrêmement inspirante et motivante dans ce contexte, de part la façon dont elle a renversée le point de vue occidental toujours dominant sur ce qu’est l’académique ou le savoir.
Par exemple, dans son exposé le professeur Teren Sevea a souligné la relation entre les connaissances traditionnelles, par exemple celles des faiseurs de miracles, et le domaine universitaire qui souvent ne réfléchit pas vraiment aux différents concepts de réalité et de rationalité. Dans son exposé, il mentionne ce qui s’est passé en 2014, lorsqu’un avion a disparu et comment les faiseurs de miracle ont pu prévoir ce que les experts ne pouvaient pas, en disant que cet avion serait retrouvé sur une île, ce qui s’est effectivement produit par la suite. Je me demande ce que vous en pensez, parce que tout ce programme était très fascinant pour nous et nous pouvions y voir une sorte de ligne conductrice. Voulez-vous parler de ce concept ?
Cosmin Costinas: C’est peut-être le cas. Je pense qu’il est important de dire que nous étions beaucoup en conversation avec Simon Soon, donc je pense qu’il serait important de reconnaître cela tout d’abord. Il est l’un des deux invité·e·s à qui nous avons également proposé de travailler à Kinshasa (la seconde était Ema Tavola). Parce qu’il était là et parce que nous avons un historique de collaborer, nous avons conçu ce programme ensemble dans une large mesure. Il est évident que nous étions très intéressés par certains types de connaissances et de personnes travaillant d’une manière particulière dans certains domaines et certaines hybridations.
Nous avons commencé par ignorer l’héritage du Bauhaus. C’était ça l’idée ; non pas de le déconstruire, non pas d’y répondre, certainement pas d’identifier ses manifestations locales, mais de trouver la meilleure façon de l’ignorer fondamentalement, de travailler en ayant surmonté son héritage comme prémisse. De manière spéculative, mais en faisant toujours cette revendication. Nous étions en effet très intéressés par les différentes manières de déconstruire l’affirmation de la rationalité, dans le cadre de la modernité occidentale. La proposition spéculative de travailler à partir du principe que nous avons déjà surmonté l’héritage du Bauhaus, nous a permis de nous imaginer dans un moment qui n’est pas encore là, mais que nous aurions néanmoins pu imaginer. Cela nous a amenés à nous intéresser à d’autres formes de circulation, d’idées, de liens, de styles.
Des circulations qui se produisent dans différentes géographies d’une part, mais aussi des circulations qui se produisent de manière non hiérarchique d’autre part, en opposition à la manière dont le Bauhaus s’est diffusé et s’est organisé dans le processus de conquête du monde. Il y a donc eu des histoires et des lignes particulières, qui sont venues naturellement grâce au travail de collègues que nous admirons et avec lesquels nous voulions travailler.
Organiser des conférences est une chose très différente d’organiser des expositions d’art. C’est un processus différent. Lorsque certaines des constellations du symposium se sont formées et nous sont apparues, nous avons ajouté des personnes pour rendre certains aspects plus clairs ou pour les orienter dans des directions différentes.
Elsa Westreicher: Même si c’est très intéressant et il y aurait tant à ajouter, mais je pense qu’il serait sage de passer à la question suivante. Celle-ci est pour Anqi. À Hong Kong, et dans de nombreux endroits de la planète, nous assistons à divers actes de résistance contre des systèmes oppressifs, axés sur les structures économiques, les questions environnementales ou l’éducation. Lors de la conférence internationale de Para Site en 2019, il y avait un fil conducteur qui reflétait les modes de résistance par le design sur une longue période historique, s’étendant sur de nombreux siècles dans le passé jusqu’à aujourd’hui. Je suppose que nous avons déjà abordé ce sujet, mais quelles sont vos réflexions à ce sujet par rapport au Hong Kong contemporain ?
Anqi Li: Tout d’abord, personnellement, je me sens assez chanceuse et reconnaissante de pouvoir participer à la conférence internationale, non seulement en tant qu’organisatrice mais aussi en tant que participante, car je pense que la conférence a vraiment permis de rassembler les voix d’orateurs venus de nombreux endroits, de nombreuses régions différentes. Ils ont pu partager, discuter, débattre de différentes opinions ici.
Nous trouvons beaucoup de luttes et de souffrances communes, en pensant à Hong Kong mais aussi à de nombreux autres endroits du monde. De ce point de vue, le symposium a démontré que Hong Kong est un hub très ouvert, où de telles idées peuvent se rassembler pour être échangées. C’est pourquoi j’ai moi-même rejoint Para Site. J’ai déménagé à Hong Kong il y a environ six mois. Je vis un Hong Kong différent de ce qu’il était avant l’été 2019. Mon expérience aurait donc pu être bien différente auparavant. Ce que j’observe à Hong Kong aujourd’hui, c’est que les gens cherchent constamment des solutions aux problèmes qui apparaissent au cours des grandes luttes sociales et, personnellement, je ressens l’anxiété, l’incertitude, et je vois parfois la peur, parfois l’intrépidité des gens, avec tout ce qui s’est passé au cours des six derniers mois ici à Hong Kong.
Et je pense qu’en participant à la conférence internationale, nous partageons la même vision que vous. En tant que co-présentateurs, je pense que nous encourageons la solidarité et les différentes opinions à être présentées lors de la conférence. Nous pouvons parler, nous pouvons partager et nous pouvons apprendre des idées présentées par des orateurs de différents pays. Nous sommes tous au diapason avec les différentes perspectives qui ont été partagées lors de la conférence. Après tout, nous voulions que les participant·e·s emportent quelque chose qui les aiderait au-delà de l’événement lui-même. Nous espérions que la discussion se poursuivrait après que les orateurs aient quitté la scène. Peut-être en parlant au public autour d’un repas ou dans tout autre lieu ou circonstance. Nous pourrions poursuivre cette conversation et parler du Hong Kong contemporain, mais ce que je voudrais souligner, c’est que je pense que ces idées présentées lors de la conférence sont en effet les bienvenues ici et qu’elles inspirent les gens, qui eux se sont sentis encouragés par les conversations ouvertes qui ont eu lieu ici.
Arlette Ndakoze: La question suivante est pour Cosmin. Le concept de cette conférence internationale peut être lu sur votre site web. Nous aimerions faire référence à la langue internationale que vous avez mentionnée dans celui-ci. Quelles sont les caractéristiques de la langue internationale ou internationaliste à laquelle vous faites référence dans vos notes conceptuelles, notamment en ce qui concerne les invités et les thèmes de votre conférence de 2019 ? Vous en avez parlé de différentes manières, mais peut-être voulez-vous ajouter quelque chose de spécifique à propos de ce langage.
Cosmin Costinas: C’était aussi une spéculation. Cela faisait partie de la même stratégie que de s’imaginer avoir déjà vaincu le Bauhaus. Il s’agissait d’un contrepoint au cadre internationaliste très clairement articulé du Bauhaus et des autres systèmes du même héritage. Nous ne revendiquions donc certainement pas une langue internationaliste unique et unifiée, nous ne prétendons pas que celle-ci existe ou qu’elle devrait exister en tant que telle. Mais il y a un long débat sémantique ici à Hong Kong sur ce que serait le terme pour décrire ce sens de la solidarité internationale, le système de pensée commune, de fabrication et d’action communes, auquel nous nous attelons tous. Et dans une certaine mesure, nous travaillons également avec cela en tête, donc quelque chose est en place et fait partie de la réalité. Mais je suppose que l’intention est d’essayer de comprendre comment le définir au-delà de la sémantique. S’agit-il d’internationalisme, de cosmopolitisme, de transnationalisme, etc ? Très souvent, ce genre de discussions sémantiques ne résout pas vraiment le problème. Ce n’est pas vraiment une question de sémantique, mais plutôt de substances et de comment travailler à l’amélioration de ce que nous avons déjà dans une certaine mesure.
Arlette Ndakoze: Dans le cadre de ce projet, l’une des principales questions est de savoir comment rendre possible un mode de vie commun et collectif. Et nous avons beaucoup pensé à ce que vous avez mentionné, et à ce qu’Anqi a dit. Que diriez-vous de cette tension qu’il y a lorsqu’on s’ouvre à des opinions différentes, car on doit aussi éviter d’être violent en respectant la propre façon de penser de chacun?
Cosmin Costinas: Évidemment, nous n’ouvrons pas vraiment l’espace à toutes les idées, c’est très important, surtout dans le contexte compliqué de notre époque, où même dans des espaces qui étaient autrefois plus sûrs politiquement, sont maintenant infiltrés par d’autres positions. Nous devons faire preuve de discernement. Il ne s’agit pas de créer une famille heureuse pour toutes les idées, pour la liberté d’expression et de créer un parapluie pour l’humanité entière. Mais il s’agit certainement de faire des choix curatoriaux et de prendre position vers une certaine direction. Dans ce contexte, bien sûr, il faut une certaine largeur d’esprit en comprenant aussi que si nous pensons à l’héritage du Bauhaus, ce langage lui-même peut être oppressant. Le langage peut cacher beaucoup de choses. Ignorer les connaissances qui utilisent différentes formes de langage pour s’exprimer et pour habiter le monde peut être très limitatif. En ce sens, il est certainement important de s’ouvrir à des langues différentes ou d’inviter des personnes qui tentent de faire des choses intéressantes dans le milieu universitaire malgré les difficultés. Il est important de s’ouvrir à des personnes travaillant dans d’autres domaines, des personnes qui travaillent en dehors de ce langage ou qui créent leur propre langage car ils trouveraient certaines formes de langage inaccessibles ou que tel langage ne suffirait pas à ce qu’ils veulent exprimer.
Elsa Westreicher: Je veux ajouter une petite réflexion, parce que je trouve très intéressant de voir Para Site ainsi que S A V V Y comme des espaces qui essaient de proposer une certaine collectivité et une façon pour elle d’être vécue dans la réalité que vous avez décrite. C’est là que je vois un lien avec l’idée de la spéculation, qui actualise l’imaginaire en quelque sorte. Il y a toute une section du design, où le mot « spéculatif » est devenu très en vogue. Des gens par exemple décrivent leur pratique de « design spéculatif », et la création pour eux ne fait pas tant partie d‘une idée moderniste du design consistant à créer des solutions à certains problèmes perçus, mais plutôt à se demander quel type de réalités imaginaires on pourrait créer et dans quel type de forme-langage celles-ci seraient reflétées, et quelle collectivité cela engendrerait. C’est pourquoi je trouve assez intéressant que vous utilisiez le mot spéculatif pour décrire votre approche. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cette réflexion. Sinon, nous pourrions passer à la question suivante.
Cosmin Costinas: C’est logique, oui. C’est en rapport avec ce que nous avons dit, tout à fait. Mais oui, je suis d’accord pour passer à la question suivante.
Elsa Westreicher: Ok. Celle-ci irait à Anqi. En marge de la conférence, Para Site a également organisé les ateliers pour les professionnels émergents, qui ont été mis en place par vos soins. Pourriez-vous nous expliquer un peu ce que sont ces ateliers annuels, ce que vous avez voulu faire et quel était leur objectif cette année ?
Anqi Li: Nos ateliers pour les professionnels des arts émergents ont commencé en 2015. Il s’agit d’un stage intensif de commissariat de neuf jours, mais nous voulons aussi en faire un laboratoire d’expérimentation, un espace de rencontre, de collaboration et d’amitié pour différents types de professionnels émergents. Ce n’est donc pas vraiment un programme de commissariat comme les nombreux autres programmes académiques qui existent. Nous voulons que les gens se rassemblent ici. Nous voulons inviter les gens à Hong Kong pour qu’ils puissent avoir une meilleure compréhension de la scène artistique d’ici. Nous voulons leur donner l’occasion de voir, d’expérimenter et de savoir quelle carrière ils pourraient vouloir suivre. Il y a un côté pratique, mais ce n’est pas vraiment une formation en soi. Nous voulons leur donner les compétences et l’état d’esprit nécessaires pour qu’ils soient prêts à faire carrière dans les arts. Pour la conférence internationale de cette année, nous avons eu une approche légèrement différente de celle des années précédentes, car nous avons invité des universitaires plutôt que des commissaires ou les artistes. Les réactions des participant·e·s aux ateliers précédents nous ont permis de constater un intérêt accru pour un plus grand nombre de visites d’institutions, ainsi que pour des conversations plus approfondies avec des chercheurs qui ont leur propre façon de mener des projets curatoriaux ou qui ont une expérience pratique de la gestion d’organismes publiques, privées ou indépendants. Nous avons donc conçu l’atelier de 2019 de manière à ce qu’il soit plus pratique. Nous avons effectué de nombreuses visites sur le terrain, et nous avons essayé de créer des groupes plus petits pour que ce ne soit pas seulement quinze personnes qui parlent à une personne, mais que cela permette des conversations plus intimes. Un exemple serait la visite du bâtiment Foo Tak, dont vous vous souvenez peut-être. Cette maison à plusieurs étages accueille plusieurs organisations artistiques telles que le Rooftop Institute, l’Archive of the People, Liber Research Community. La visite a non seulement permis aux institutions de se présenter et d’expliquer ce qu’elles font, mais aussi aux étudiants de poser des questions, par exemple sur la manière dont elles abordent leurs recherches universitaires, etc.
Les institutions sont intéressantes, mais cela devient plus intéressant quand il y a une conversation entre elles et les participant·e·s. Cela s’est plutôt bien passé et nous avons reçu de bons commentaires à ce sujet. Bonne nouvelle, nous avons commencé à recevoir les nouvelles demandes d’inscription pour les ateliers de 2020. C’est très excitant à lire, beaucoup de nouveaux candidat·e·s sont recommandés par des personnes qui ont déjà participé aux ateliers. C’est là notre véritable espoir : développer un réseau de jeunes commissaires, universitaires et écrivains. Ils seront la nouvelle génération qui arrivera dans l’industrie, et nous nous demandons comment maintenir la dynamique de ce groupe. Para Site souhaite leur fournir des opportunités d’exposition et de permettre à un plus grand nombre de candidat·e·s de participer. Nous voulons absolument encourager les participant·e·s aux ateliers à postuler à nos opportunités d’exposition. Nous fournissons le budget de l’exposition et toutes sortes d’aides à la production et même du mentorat. Tout cela peut contribuer à une meilleure écologie dans les arts. Nous voulons donc contribuer à la réalisation de cet objectif et offrir des occasions équitables aux commissaires et chercheurs émergents afin qu’ils puissent poursuivre leur carrière artistique.
Elsa Westreicher: Il est intéressant de constater qu’une communauté émerge à travers cela. Le fait d’avoir fait cela pendant cinq ans et d’en être maintenant à la sixième itération permet de constater qu’un processus d’apprentissage a eu lieu au sein de Para Site. Le fait qu’il y ait une continuité, contrairement à l’effet d’un projet unique qui perd de sa force une fois terminé, est important, je pense. Surtout dans une réalité où un tel intérêt continu n’est pas facilement atteint et où les espaces d’art luttent pour survivre. J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir suivre le programme que vous avez organisé pour les ateliers et d’avoir pu partager votre vision de Hong Kong. Celle-ci était en effet très diversifiée, passant par des lieux institutionnalisés ainsi que des initiatives autogérées. Je pense également à toutes les conversations incroyables avec les participant·e·s, dont beaucoup étaient déjà très impliqués dans leurs propres initiatives et projets. D’une certaine manière, je suppose que Para Site est une entité qui accueille et donne en retour, reçoit et rend. Voulez-vous dire quelque chose à ce sujet et peut-être aussi expliquer pourquoi vous avez choisi ces institutions particulières pour les visites ?
Cosmin Costinas: En ce qui concerne la dernière partie de votre question, je pense que nous essayons d’être aussi inclusifs que possible. Peut-être même un peu plus inclusifs que ce que nous sommes normalement pour la conférence, comme je vous l’ai expliqué précédemment. Parce que c’est aussi une question de solidarité et de mise en valeur de vos pairs. Mais il s’agit aussi d’un exercice un peu éducatif où nous devons donner aux participant·e·s une connaissance et une compréhension plus larges de ce qui se passe dans la ville. Nous les emmenons donc dans des institutions qui sont peut-être un peu différentes de nous ou dans des expositions qui ne feraient pas partie de celles que nous mettrions en valeur dans un autre contexte. Maintenant, pour le reste de votre question, à peu près tout ce que nous faisons est très lié à Hong Kong. C’est donc très clair. Mais il est également très important de comprendre, ce que cela signifie et ce que cela dit sur Hong Kong. Parce qu’il y a des choses qui sont très directement liées et facilement reconnaissables comme des conversations à propos de problèmes qui se produisent à Hong Kong. En ce qui concerne d’autres sujets, le lien est moins évident. Il est très important de dire qu’une partie de ce qu’est Hong Kong est une ambiguïté et une éphémérité, si l’on veut être mélancolique à ce sujet. Mais c’est aussi un espace de rencontre à bien des égards. C’est l’un des rares endroits où de telles conversations peuvent avoir lieu entre des personnes de la région ou d’autres parties du monde tout en ayant des façons très différentes de comprendre les questions de pouvoir ou de hiérarchie qui se posent dans de nombreuses réunions de ce type. C’est une ville qui n’a pas de projet impérial en soi, par rapport aux autres villes riches du monde, auxquelles tout profiterait ou ferait inévitablement partie d’une conversation du projet hégémonique qu’elles ont. Que ce soit Singapour qui aime se positionner comme une sorte de plaque tournante ou de capitale de l’Asie du Sud-Est, ou Tokyo, avec son passé compliqué. Sans même parler des villes occidentales. C’est très différent dans le cas de Hong Kong, car sa propre identité est si contestée et si compliquée et sensible, qu’il n’y a pas d’exercice de branding ou de véritable projet impérial dont la ville serait le sujet. Il est donc très intéressant d’être dans cette situation assez rare, où beaucoup de choses sont possibles. Nous essayons d’en tirer profit. Avec les nombreux projets que nous réalisons, nous mettons en évidence la nature de Hong Kong. Ainsi, même si le sujet n’est pas immédiatement et évidemment lié à cette ville, il y est tout de même très lié. De nombreux projets que nous faisons et ne pourraient être réalisés qu’à Hong Kong, et ils sont d’ailleurs définis par l’esprit et les réalités de la ville.
Anqi Li: De mon côté, je pense que les fondateurs de Para Site, nos collègues précédent·e·s, ont déjà constitué de grandes ressources, et une grande réputation pour Para Site. Je dirais que nous, membres de Para Site, voulons absolument faire bénéficier de ces avantages les participant·e·s de nos ateliers, les mettre en contact avec des gens de l’industrie, pour leur donner l’occasion d’apprendre, de faire ce qu’ils veulent. En effet, lors de la sélection des participant·e·s à l’atelier, nous posons également la question « qu’attendez-vous de cette expérience ? ». D’autre part, comme l’a dit Cosmin, je pense que les individus font eux-mêmes le trie des informations provenant de différents projets ou événements. De notre côté, puisque nous faisons un programme de groupe, nous voulons nous assurer que les gens ne négligent pas toutes les choses qui se passent dans la ville. Même s’ils les filtrent déjà individuellement. C’est notre mission en tant qu’éducateurs ; de fournir beaucoup et donner aux participant·e·s la liberté de choisir ce sur quoi ils veulent se concentrer.
Arlette Ndakoze: Ceci est un commentaire sur la façon dont nous pouvons établir de nombreux parallèles entre un espace comme Para Site, en particulier en termes de contenu et de ce que vous faites, et l’approche que nous adoptons à S A V V Y. En la possibilité d’un espace, d’être ou d’incarner un certain monde dans lequel on peut exister. Je pense beaucoup à ce que vous avez dit, Anqi et Cosmin, que cela ressemble à un certain monde qui n’est pas encore le monde, mais une sorte de réalité ou peut-être pas encore, mais qui existe au sein des êtres et que l’on peut imaginer. Et cela ne se passe-t-il déjà pas? Vous savez, nous pensons toujours à un monde et à de nombreuses choses auxquelles nous devrions nous adapter ou auxquelles nous devrions penser, vivre d’une certaine manière ou penser d’une certaine manière. Mais voir qu’il se passe déjà quelque chose dans un espace où les gens sont prêts à s’ouvrir à certaines choses et à voir quelles sont les limites afin que nous puissions nous réunir. C’est à ça que je pense beaucoup, au design et à la façon de concevoir un espace qui pousse les choses de plus en plus loin.
Cosmin Costinas: Et comment voyez-vous l’avenir de ce projet ? Ce serait intéressant à entendre, parce que très souvent et trop souvent, beaucoup de projets créent un moment intéressant, et une situation intéressante qui ne se prolonge nulle part, parce que le projet a son point final naturel. Cette situation n’est donc pas maintenue. Comment voyez-vous cela ?
Elsa Westreicher: On peut voir les deux côtés, je pense. Parfois, il peut être bon de clore un chapitre, en fait. Ce projet a été le point de départ de beaucoup de choses qui pourraient se réapparaitre sous de nouvelles formes. Nous sommes vraiment passés par un long processus avec ce projet à S A V V Y, avec tous ceux qui y ont participé bien sûr – S A V V Y est une grande famille et seuls quelques-uns d’entre nous ont travaillé directement sur le projet – mais comme chaque projet, celui-ci a également créé des ondes sismiques qui influencent l’espace. Je pense aussi aux personnes qui ont participé à l’école d’été à Berlin. À Hong Kong, lors de la table ronde, nous avions déjà mentionné que ce processus d’apprentissage, ou de désapprentissage (unlearning), n’est pas nécessairement toujours agréable. Il y a aussi beaucoup de guérison à faire, en fonction de nos capacités individuelles du moment. Cela vaut pour l’équipe, mais aussi pour les participant·e·s. Les moments et les rencontres, ou les rencontres comme celles de Triangles Tournoyants génèrent quelque chose, des liens et des heurts, du “confort et inconfort” comme s’appelait l’un des ateliers (de Jean-Jacques Tankwey). Mais il est difficile de déterminer avec précision ce qui est généré. Cela a quelque chose à voir avec la façon de se comporter les uns avec les autres et de signaler la douleur. Il n’est peut-être pas utile de dire « c’est exactement ce qui s’est passé, et c’est le résultat ». Le résultat, si l‘on veut utiliser le terme, est ce processus continu lui-même, pour faire face à un changement, même si cela peut paraître abstrait et très subjectif. C’est la meilleure façon dont je peux exprimer ce que je ressens actuellement. En ce qui concerne Kinshasa, je peux dire que les discussions que nous avons eues et les liens qui ont pu être créés ont eu des conséquences. J’ai entendu dire récemment, lors d’une conversation avec Jonathan Bongi, l’un des membres du groupe de recherche de Banka qui a été initié dans Triangles Tournoyants, que ce dernier envisage par exemple sérieusement de créer un centre d’apprentissage, où les connaissances seraient partagées à un niveau plus large que dans certains des espaces d’apprentissage plus institutionnalisés de Kinshasa. Il veut regrouper les différents savoirs dans la ville et leur donner un espace commun de réflexion sur leurs pratiques. Entendre quelque chose comme ça dans une conversation informelle est quelque chose de vraiment beau. Qui sait ce qui est initié ensuite, au-delà de S A V V Y ou de notre propre intention. A part tout ça, je pense que les nœuds qui se sont noués vont être difficile à délier. Ce que S A V V Y fera avec cette expérience au niveau pratique n’est pas encore déterminé, mais c’est quasi certain qu’il y aura des conséquences, pour la programmation peut-être et pour reprendre les fils.
Arlette Ndakoze: Je dirais simplement que de toutes ces rencontres communes, et ce qui a été formidable dans ce projet, c’est qu’il a permis de rencontrer, pendant un moment intense, des personnes de diverses institutions et de contextes culturels, également philosophiques, qui réfléchissent à ces questions de manière variée. Mais parfois, par exemple lorsque Elsa a conçu ce concept, nous ne pensons pas à tout ce que nous faisons déjà dans notre vie quotidienne. Combien ces formes sont déjà en nous et combien en nous réunissant, nous pouvons les partager, et réaliser comment en être simplement conscient·e. Je pensais à comment l’écriture avec la police de caractère Times New Roman façonne notre vision des choses, et au fait qu’elle pourrait être une autre police. Mais avec cette autre police, nous penserions aussi différemment. Il en va de même pour la façon dont nous nous asseyons ou saluons quelqu’un, ces questions autour des pratiques de convivialité faisaient déjà partie de projets précédents chez S A V V Y. Mais quand je pense à ce projet de design, la question était plus intensément centrée sur la façon dont nous pouvons réellement concevoir les outils de nos environnements quotidiens afin de rendre ce futur collectif possible ? Alors qu’auparavant, nous réfléchissions beaucoup au sentiment d’appartenance. Comment cela pourrait-il se produire ? Comment pouvons-nous avoir un sentiment d’appartenance qui englobe toutes les conditions du monde ? C’est une question qui a été posée dans le cadre du projet Géographies de l’Imagination qui s’est déroulé avant Triangles Tournoyants. Bonaventure Ndikung et Antonia Alampi ont donc réfléchi à la façon dont la pensée coloniale a été façonnée.
J’en suis venu à me demander ce que cette école, cette école occidentale, voulait faire, par la façon dont elle nous enseignait, comment la pensée du mode capitaliste y était intégrée. Nous n’avions pas le droit de juste exister à l’extérieur et de voir les choses comme vous l’avez fait avec les ateliers et de nous réunir et d’échanger. Il y avait vraiment un programme. Nous devions l’apprendre et ensuite nous devions avoir un résultat, un produit. La plupart du temps, nous réfléchissions avec nous-mêmes, mais nous n’avions même pas le droit d’exprimer nos idées. Parfois, bien sûr, nous discutions. Mais il y avait toujours quelque chose que le professeur aurait voulu entendre. Nous pensions donc à cela avec nos collègues, que cela fait partie de la façon dont le capitalisme est façonné. Ce sont les choses auxquelles je pense que l’on peut réfléchir de manière plus intensive avec ce département de design et avec Triangles Tournoyants. Et pour donner un exemple, quelqu’un a récemment contacté le département de design ; cette personne s’est rendu compte que l’on ne parle pas beaucoup de la mort dans notre société et qu’elle envisageait de discuter avec les membres du département de design à propos des pratiques autour de la mort et sur la façon de l’intégrer à la vie. Donc pour moi, je pense que c’était un des résultats, qui nous fait voir le processus de cette ouverture.
Ou bien voulons-nous tous nous entendre dans l’avenir – à partir d’aujourd’hui –parce que demain n’existe pas ?
Une conversation avec Lambert MoussekaArlette Ndakoze: Bonjour Lambert, voulez-vous vous présenter d’abord ?
Lambert Mousseka: Bonjour Arlette. Oui, bien sûr. Je suis Lambert Mousseka Ntumba. Je suis né en R. D. Congo, dans le sud, et j’ai vécu à Kinshasa, où j’ai également fait une partie de mes études. Plus tard, j’ai déménagé à Stuttgart pour étudier à l’Académie des Arts. Je suis un acteur, un marionnettiste mais aussi un artiste en général, comment dire, je suis un artiste libre, c’est ce que je suis.
Arlette Ndakoze: Comment devient-on marionnettiste ? Comment y parvient-on ? C’est assez inhabituel, du moins d’après ce que nous savons ici.
Lambert Mousseka: Vous pouvez étudier les marionnettes, je l’ai fait, mais pas dans le genre d’école que vous pouvez imaginer. Toute ma vie, j’ai essayé d’étudier différemment. Même si j’ai fini dans une école normale et conventionnelle, j’ai toujours étudié différemment. J’ai fait diverses formations et ateliers dans différents endroits au Congo, en France, en Allemagne, et dans bien d’autres endroits. Partout où je suis allé, j’ai essayé d’apprendre quelque chose de nouveau et de donner aussi quelque chose, de donner quelque chose de différent. C’est la meilleure façon d’apprendre; en faisant et en partageant. Au Congo, il n’y avait pas de véritable tradition de marionnettes de manière professionnelle, sur scène. C’est pourquoi j’ai cherché différentes possibilités là où c’était possible. Donc je me suis retrouvé dans des endroits différents. Je ne dis pas que j’ai toujours recherché le théâtre de marionnettes, mais plutôt que les marionnettes m’ont trouvé. Et puis nous avons fait un voyage ensemble, en effectuant diverses tournées et en visitant divers lieux pour nous produire. Mais pas seulement de manière traditionnelle, parce que pour moi, il est important que lorsqu’on dit « oh un acteur, un marionnettiste du Congo – alors il ne joue probablement que le théâtre de marionnettes congolais », mais qu’on soit surpris. Nous sommes aujourd’hui dans un monde très ouvert, où les gens disent « je ne fais pas seulement du théâtre moderne ou traditionnel ». Je donne au monde le meilleur de moi-même, parce que le monde m’a aussi donné une mission. Les marionnettes sont cette mission, que je peux à nouveau partager avec le monde.
Arlette Ndakoze: Si vous dites que les marionnettes vous ont trouvé et qu’en même temps il n’y avait pas d’école de marionnettes au Congo, comment vous ont-elle trouvé ?
Lambert Mousseka: Il n’y a pas d’école conventionnelle pour les marionnettes au Congo, mais depuis cette rencontre, avec les marionnettes, il existe une forme d’école au Congo. Pour moi, cela n’était pas possible parce que j’étais étudiant au Congo à l’époque, où il n’y avait pas d’école de marionnettes, j’ai étudié autre chose. J’ai étudié le marketing à l’université et en même temps j’allais à l’école de théâtre. Il y avait un atelier de théâtre et parmi eux, un marionnettiste de Strasbourg, du TJP (Théâtre Jeune Public – Centre Dramatique National Strasbourg). Seules deux personnes y participaient alors que tous les autres ateliers étaient complets. Soudain, je l’ai vu enseigner dans son atelier, de très loin. Je n’étais pas dans son groupe et je l’ai vu jouer avec une marionnette et expliquer des choses aux autres participants. Et soudain, comme dans un rêve, la marionnette m’a fait signe, elle m’a dit « viens » et je me suis retrouvé là, sur l’invitation d’une marionnette, comme un M. Punch ou autre. Cette marionnette m’a appelé et c’est comme ça que je suis arrivé là. Mon intérêt pour cette forme de théâtre, de ce que l’on pouvait en faire et s’il en existait d’autres formes, a persisté par la suite. Je suis une personne très curieuse, j’ai cherché toutes sortes de marionnettes. Jusqu’à aujourd’hui, je ne les connais pas toutes, personne ne peut dire qu’il sait tout, mais je sais approximativement, selon le projet, quand je veux développer une pièce de théâtre, quels types de marionnettes je veux utiliser. Dans cette variété, il y a beaucoup de liberté sur la façon de traiter les marionnettes. Mais ce qui est important pour moi, c’est que vous n’avez pas besoin d’une vraie école avec des bâtiments, des chaises, où aller et étudier. Je pense que c’est une fausse façon d’apprendre. On devrait faire des choses. Apprendre en faisant, comme on dit. Parfois, on pense que c’est la mauvaise voie, mais en fait, c’est la bonne. Parce qu’alors il n’y a pas de pression pendant l’apprentissage, ça vient comme ça vient et s’en va comme ça s’en va.
Arlette Ndakoze: Vous voulez parler de marionnettes ou d’apprentissage en général ?
Lambert Mousseka: Oui, également peut-être dans d’autres sciences ou d’autres domaines artistiques. Il est important que dans l’art, ou la marionnette, ou dans quoi que ce soit que vous fassiez, il y ait une rencontre, c’est-à-dire que vous n’essayiez pas de faire quelque chose par force mais que vous ayez une rencontre avec la chose que vous êtes censée faire. Il n’y a donc pas de pression, il faut que ce soit un coup de foudre, mutuel, et puis ça marche. C’est pourquoi je dis toujours qu’en matière de marionnettes, on ne peut pas dire « je vais à l’école pour apprendre ». Vous pouvez faire cela aussi, mais la plupart des gens qui font cela, finissent dans un magasin, ils seront vendeurs ou peut-être peintres ou feront autre chose parce qu’ils ont cherché quelque chose mais ils n’ont pas eu de coup de foudre. Et c’est pourquoi je pense que l’école n’est pas la mauvaise voie, mais qu’elle doit venir d’une volonté intérieure, et ensuite seulement aller vers l’extérieur.
Arlette Ndakoze: Ce marionnettiste de rue de Strasbourg, ce marionnettiste qui a donné l’atelier et qui avait une marionnette qui vous faisait signe, je me demande trois choses : quelle était cette marionnette ? Qu’est-ce qui vous a attiré, selon vous ? Et dans quelle mesure ce qu’il a apporté là-bas faisait déjà partie de ce que vous saviez ou peut-être ne saviez pas ?
Lambert Mousseka: Il est difficile de dire de quel genre de marionnette il s’agissait, curieusement, ce n’était pas une marionnette mais un objet. C’était une sorte de théâtre d’objets, c’est pour cela que j’étais si enthousiaste par le fait que l’on puisse jouer avec des objets et que les objets puissent jouer le rôle de personnes. Alors je me suis dit « wow, comment puis-je faire ça moi-même? », en prenant un morceau de bois, une chaussure et une vieille chaussette et des choses comme ça. C’est ce qu’il a utilisé pour créer toute une histoire. A partir de là, tout a commencé, avec d’autres formes et marionnettes, mais celles là sont venues plus tard. Je n’avais jamais entendu parler de ce genre de marionnettes ou d’objets avant, c’était la première fois. Puis j’ai voulu en savoir plus et c’est ainsi que tout a commencé.
Arlette Ndakoze: Quand on pense à la façon dont vous êtes tombé sur ça. On parle beaucoup de la façon dont certaines choses sont ajoutées à une culture, et de la mesure dans laquelle on s’approprie cette culture ou qu’on lui impose quelque chose. Quand vous pensez à la culture que vous avez appris à connaître, que ce soit par le biais de marionnettes ou peut-être autre chose, y avait-il quelque chose qui vous rappelait ces objets que vous connaissiez déjà ou avez-vous eu le sentiment que quelqu’un venait et prenait l’espace? Je pose cette question précisément parce que nous sommes ici au milieu d’un événement où vous déconstruisez quelque chose que les illustrateurs européens ont introduit dans leurs personnages ou leurs dessins animés: des structures coloniales, des stéréotypes... Comment vous sentiez-vous à cette époque. Quand vous regardez en arrière, étiez vous d’accord?
Lambert Mousseka: Oui, j’étais d’accord, parce que c’était un de ces moments qui m’ont apporté d’autres choses. Parce qu’à partir de ce moment, après avoir fait cette rencontre avec ces objets et ces personnages, cela m’a ouvert les yeux, un espace s’est ouvert à moi. Cet espace est le pays et la ville où j’ai vécu, le quartier où j’étais et la maison où j’ai séjourné. Pourquoi est-ce que je dis tout cela ? Parce que c’est exactement dans ces espaces et cet endroit, que j’ai dû faire face à cela. Une fois l’atelier terminé je me suis demandé, comment continuerais-je, que ferais-je par la suite ? J’ai dû chercher, dans le pays où je vivais, quel genre d’objets on pouvait utiliser pour le théâtre, où se trouvaient ces objets? Grâce à mes propres recherches, je ne dirais pas que j’ai trouvé, car ce serait une forme d’arrogance, mais j’ai obtenu des informations selon lesquelles le théâtre de marionnettes était en fait déjà ici. Au Moyen Âge et même avant. Je me suis rendu compte que déjà à l’époque des pharaons, le théâtre de marionnettes et les marionnettistes existaient en Afrique. Mais nous n’en parlons pas de cette façon ou nous ne lui avons pas donné ce nom. Il avait d’autres formes et d’autres noms. C’est peut-être comme le ballet traditionnel en Afrique ou au Congo, la danse traditionnelle ou la danse avec des masques. Le nom de marionnette est pour moi encore aujourd’hui une chose coloniale parce qu’on essaie de caser la discipline dans un tiroir et de la glisser dedans. Mais il ne faut pas limiter une telle forme d’art, lui donner un terme ou un nom et s’y tenir ensuite. Parce qu’elle peut avoir en effet une grande variété. On peut dire que le théâtre de marionnettes n’est pas seulement un théâtre de marionnettes parce qu’il utilise des marionnettes construites. Vous pouvez tout utiliser sur scène. Cela peut être n’importe quoi, un conte de fées traditionnel ou un texte contemporain, selon les moyens que vous utilisez. Tout cela a été possible grâce à un élément, qui a éveillé ma curiosité. Même aujourd’hui, quand vous voyez tous mes projets de théâtre, les marionnettes en font toujours partie. Pour moi, c’est très important en tant qu’artiste car c’est de là que me vient l’inspiration. Laissez-moi vous donner un petit exemple : Ceux qui veulent étudier la musique en Europe s’attardent sur du Mozart, du Bach, etc. Après leurs études, ces personnes essaient de travailler dans un orchestre symphonique où elles continuent à jouer Bach, Mozart, etc. Certaines personnes restent à ce stade et ne deviennent jamais créatives, ne font pas leur propre musique. Au final que laissent-elles derrière elles dans ce monde ? Encore du Bach et du Mozart. Mais ces personnes étaient aussi des êtres humains, nous sommes aussi des êtres humains, nous laissons aussi des traces sur cette planète. Et à travers d’autres traces, nous nous inspirons de ce qui était jadis dans ce monde, et constituons une partie de nos connaissances à ce sujet, et il y a des éléments que nous laissons également à la génération suivante. Puis la génération suivante vient et prend un morceau de ce que j’ai laissé derrière moi et un morceau du vieux marionnettiste de mon village et rassemble tout cela et apporte sa contribution. Ensuite, trois personnes travaillent sur un morceau, et ainsi de suite. Je n’aurais jamais, par exemple, travaillé toute ma vie dans un théâtre où je n’aurais jouer que du Shakespeare. Parce que j’ai aussi envie d’écrire mes propres pièces et c’est ce que je fais. C’est une bonne approche pour moi. Je sais ce que Shakespeare, Goethe, Schiller et tous les autres ont écrit. Il est important de disposer de ces informations. Mais pour moi aujourd’hui, il est important de trouver ma propre place entre Schiller, Goethe et Shakespeare. C’est très important.
Arlette Ndakoze: Quand vous dites, ces éléments que vous avez vus là, ces objets, qui font aussi partie de votre culture et dont il y a encore des traces dans vos pièces, pourriez-vous nous donner un aperçu de ce qu’il y a dans vos pièces, vous pourriez aussi les appeler des performances, de quoi s’agit-il, et quelles sont ces traces qui ont été laissées ?
Lambert Mousseka: Oui, c’est très controversé, peut-être que certaines personnes seront déçues lorsque je discuterai du contenu de mes pièces. Je suis né au Congo, je suis congolais et mon passeport l’est aussi. Quand certaines personnes me voient, elles ont des attentes, j’appelle cela des clichés. Elles se disent « voici maintenant une histoire sur des animaux! ». Il ne s’agit pas de cela. Je vis dans le présent et il n’y a pas d’animaux dans les rues au Congo, et mes textes sont comme ça. Mes textes ne parlent pas d’un prédateur qui court dans les rues. La dernière pièce que j’ai jouée porte sur les monuments, mais avec des personnages. Et nous avons également traité des monuments qui traitent du colonialisme. L’histoire se déroule en Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid. Les Blancs d’Afrique du Sud ont construit des monuments aux héros dans tout le pays, et la plupart des héros sont blancs. Que faire de tous ces monuments après l’apartheid ? Il en va de même pour tous les pays africains ou asiatiques ou même dans des pays communistes, ces statues de héros existent toujours. En Afrique du Sud, après l’apartheid, par exemple, la jeune génération s’est occupée de cette question, et certains monuments ont été démolis à l’époque, ou déplacés du point A au point B parce qu’il n’y avait plus de place. Ceux-ci concernaient pas l’histoire de tous les Sud-Africains et ils devaient donc être enlevés. Certains d’entre eux sont des objets de conflit parce qu’une partie de la population dit que c’est important pour elle et l’autre partie dit que ce n’est pas important, et qu’elle veut qu’il soit retiré. Cela devient alors un conflit à propos d’un monument. C’est, par exemple le sujet de la dernière pièce à laquelle j’ai participé. Ce n’est pas moi qui l’ai écrite, c’est un écrivain sud-africain.
L’une des pièces que j’ai écrites et dans lesquelles j’ai également joué s’appelle Le village sur la colline. C’est à propos de la crise financière, je l’ai écrite en 2008 et deux semaines plus tard, après la première, la crise financière est arrivée. J’étais content parce que j’étais censé la joué à ce moment précis. C’est pourquoi j’ai joué cette pièce plus de 200 fois en Allemagne. La salle était toujours pleine, car le sujet était d’actualité. Les marionnettes étaient de petits personnages, certains ressemblaient à des sculptures que l’on trouve dans les musées ethnologiques, d’autres à des personnes que l’on voit dans la rue. Certains ressemblaient à des objets et ainsi de suite. C’est dans cette direction que je travaille avec mes personnages.
Arlette Ndakoze: Je suis curieuse de savoir ce que vous avez ressenti là-bas, à propos de la crise financière et comment vous l’avez affrontée dans votre pièce de théâtre.
Lambert Mousseka: Il y avait un roi dans la pièce, mais le roi n’était qu’une métaphore pour un président. Je faisais référence au fait que le Congo a été une colonie belge, et que notre roi qui n’était jamais au Congo, siégeait en Belgique. J’ai ensuite replacé cette histoire dans un contexte actuel, pour dire que la plupart de nos présidents en Afrique, que nous les ayons élus ou non, sont au pouvoir parce que les forces Occidentales l’ont voulu. Elles se moquent de savoir qui est élu ou qui ne l’est pas. Nous avons donc eu le président Mobutu qui a été président pendant 40 ans. Nous avons eu, en fait nous avons toujours, Denis Sassou-Nguesso au Congo-Brazzaville, président également depuis 30 ou 35 ans. Quand vous regardez ces pays, rien ne s’est développé, ce sont tous de bons élèves de la puissance coloniale. Pour moi, ils sont les équivalents contemporains des rois belges ou de la monarchie française ou des présidents français ou allemands ou anglais et ainsi de suite, mais directement implantés en Afrique – où les pays ont des ressources minérales et ont beaucoup d’argent – mais on ne voit pas cela.
Dans la pièce, le roi ment à son peuple. Il est question de pouvoir, de magie et de manipulation. Il dit à son peuple que tous ceux qui ont des richesses ou des biens doivent les amener à la maison royale pour protéger le roi, parce que quand la crise financière arrivera, ils perdront leur argent. Il leur dit qu’il vaut mieux qu’ils lui apportent pour qu’il le cache dans son village, et qu’il le stocke sur la colline, qui est une métaphore pour un paradis fiscal aujourd’hui. Ainsi, il leur dit que quand ils lui apporteront leur argent, lui en retour l’apportera dans le paradis fiscal, et quand la crise financière arrivera, alors ils seront protégés et ils ne perdront rien. Il ajoute: « si vous m’apportez votre argent, vous n’aurez pas à payer d’impôts dans votre pays ». Et c’est de cela qu’il s’agit, les gens apportent des choses au roi et il manigance avec un scientifique des États-Unis, de France ou de Belgique. Ces gens viennent et disent qu’ils sont ethnologues ou autre, et qu’ils nous apportent la science. Le roi répond qu’ils n’ont pas besoin de leur science ici, mais qu’ils veulent coopérer. « Nous avons besoin que les gens achètent du coltan ou du cobalt et fassent des affaires, mais nous ne devrions pas le dire à haute voix. Nous devons parler d’échanges politiques, d’économie, de droits de l’homme. Mais sous la table, nous faisons des affaires illégales, mais ce n’est pas illégal parce que nous sommes les législateurs. Et puis ce n’est pas illégal, alors nous faisons des affaires sous la table mais en surface pour les gens, nous montrons d’autres choses. » C’est de cela qu’il s’agit.
Cette pièce est joué par des petites figurines de 30, 40 cm de haut. Tout se passe sur une table, avec une centaine de personnes dans le public. C’est le genre de choses que je fais.
Arlette Ndakoze: Mais je me demande comment le thème de la crise financière a été choisi à l’époque, indépendamment des structures de la pièce.
Lambert Mousseka: Les gens doivent comprendre qu’un artiste est une personne qui vit dans ce monde mais aussi dans d’autres mondes grâce à cette chose que chaque artiste a, cette vision de quelque chose. Parfois, ce sont des visions claires, parfois elles ne sont pas claires. Mais vous en faites une forme artistique. Il peut s’agir d’un tableau ou d’une sculpture, d’une pièce de théâtre ou d’un morceau de musique. À un moment donné, cela arrive. Chez certains artistes, cela se passe consciemment, chez d’autres, il y a soudain ce moment où quelque chose apparaît. Je ne savais pas que la crise financière allait arriver. Je n’avais aucune idée de quand cela arriverait et j’ai juste eu l’inspiration et obtenu un peu de financement. C’est quelque chose que j’avais en tête depuis longtemps. C’est ainsi que cela s’est passé, vous prenez juste une bonne décision au bon moment, quand vous êtes vraiment dans le coup.
Arlette Ndakoze: Vous avez parlé d’une pièce qui se déroule en Afrique du Sud, allez-vous la jouer également en Afrique du Sud dans un avenir proche ?
Lambert Mousseka: Oui, nous étions là avant de faire la pièce, avant la première. Nous y avons fait des recherches. La première a eu lieu à Halle avec certains des artistes sud-africains de la Handspring Puppet Company. Il s’agissait d’une coopération entre les villes de Halle et du Cap, avec le Baxter Theatre en Afrique du Sud. La première a eu lieu à Halle en octobre, elle sera à nouveau jouée en janvier, février et mars. Elle sera également présenté en première en Afrique du Sud, puis elle reviendra à Halle et continuera ensuite à être en tournée.
Arlette Ndakoze: C’est aussi un sujet d’actualité ; les monuments et la reconnaissance de ceux qui ont été assassinés et pas seulement ceux qui ont été les oppresseurs. Si nous avons encore à ce jour une statue de Bismarck à Berlin, alors l’histoire doit avoir été racontée ici un peu différemment. En Belgique, il existe encore une statue du roi Léopold II. De plus, nous sommes assis ici à Dessau, qui a une longue histoire de présence de structures coloniales et de personnes qui non seulement souffrent et ont souffert, mais qui ont aussi été tuées. Oury Jalloh en est un exemple. Nous sommes ici assis, plus précisément dans une Tiny House. Nous sommes assis à côté de livres qui traitent des structures coloniales et sur les vitrines nous avons des dessins animés, de quel genre de dessins s’agit-il ?
Lambert Mousseka: Ce sont des dessins qui font référence à ce que les gens pensent. Vous avez demandé avant si ces monuments historiques ont également un lien avec l’Allemagne. Je dis oui à 100%. Car en la matière, il n’y a pas de différence entre l’apartheid en Afrique du Sud ou la colonie belge ou française. L’Allemagne est également un pays où ces sujets ont joué un rôle.
Nous avions ici deux systèmes dans un même pays, ou peut-être deux systèmes et deux pays, il y avait deux Allemagne. Puis une Allemagne a été abolie et une seule Allemagne est restée. Que faites-vous de tous les monuments communistes qui ont existé en RDA ? C’est aussi le sujet de cette pièce, cette parallèle entre l’Europe et l’Afrique. Mais quand les Européens, les Allemands par exemple, sont allés en Afrique, ils sont arrivé avec une attitude de savants, comme s’ils savaient comment tout fonctionne. Mais ils oublient souvent qu’il s’est produit en Allemagne la même chose qu’en Afrique. Qu’a-t-on fait de ces monuments de la RDA ? Que font les gens de la RDA, qui sont allés dans l’autre Allemagne, des monuments capitalistes ? Est-ce que cela leur plaît ? Désirent-ils tous cela ou non ? Que font les autres avec les monuments de Karl Marx en Allemagne de l’Est ? Toutes ces questions sont importantes et cette pièce ne visait pas à trouver des réponses, mais à réfléchir et à engendrer des discussions, afin que les gens puissent traiter ces questions. Parce que nous vivons aujourd’hui et non hier, que nous allons de l’avant et que la question est de savoir quel monde nous voulons pour l’avenir. Nous qui sommes assis ici maintenant en faisons partie, à l’intérieur de cette Tiny House, qui se trouve dans la rue Bauhaus à l’université Bauhaus. Le Bauhaus est aussi un élément de cette puissance coloniale, en s’inspirant d’autres cultures et en s’en servant comme culture allemande. Transmettre des connaissances est une bonne chose, mais pour moi, en tant qu’artiste né au Congo et vivant en Allemagne, je pense que ce n’est bon qu’en partie. Car, d’un autre côté, il est dommage que les inventeurs du Bauhaus ne disent nulle part que leur inspiration vient aussi d’autres endroits et qu’ils l’ont amenée dans cette nouvelle configuration. Ils auraient pu dire : « Si vous voulez connaître le concept exactement, vous devriez regarder ici et là et regarder l’architecture d’ici et là ». Je n’ai aucune idée dans quel genre de livre c’est écrit. Je ne pense pas qu’un tel livre existe vraiment. Mais quand je vois cette construction, cette architecture, c’est beau, c’est bien. Mais les références me manquent. Je sais qu’ils étaient en Inde où ils allaient méditer. Ils ont essayé différentes choses et différents matériaux qu’ils allaient utiliser. Même aujourd’hui, en 2019, je dirais qu’il devrait y avoir de nombreux changements dans le concept et la façon dont le vrai Bauhaus a été conçu. Comment y faire face aujourd’hui et qui voulons-nous être à l’avenir ? Voulons-nous continuer à exporter des choses vers d’autres pays et à prendre des choses aux cultures sans les référencer et sans créditer ceux qui y ont pensé avant ? Ou bien voulons-nous tous nous entendre dans l’avenir, et à partir d’aujourd’hui, parce que demain n’existe pas et qu’il n’y a qu’aujourd’hui? Personne n’existe déjà demain ou après-demain. Et pour moi, ce temps, qui existe, est le temps du maintenant. Ou voulons-nous dire que, maintenant, chacun peut faire ce qu’il veut parce que le monde est maintenant un monde avec une culture commune ? Et ainsi se rappeler que personne ne vaut plus que l’autre, et oublier que la créativité de l’un vaut moins que celle de l’autre ?
Moi, par exemple, je ne veux pas vivre dans un tel monde. Ces caricatures y font référence, elles sont en rapport direct avec ce sujet. Il s’agit là d’une méthode visant à donner aux gens un espace dans lequel ils peuvent s’exprimer. S’exprimer ne signifie pas seulement traiter toutes sortes de sujets car quand on parle de Bauhaus, ce n’est pas seulement du Bauhaus qu’on parle. Il faut aussi parler de Dessau, comment se fait-il que le Bauhaus soit ici ? Les gens l’ont-ils souhaité ou la ville a-t-elle simplement décidé de l’accepter ici et d’essayer pour voir ? Et comment les gens s’accommodent-ils de cette construction qui se trouve ici ? Et les étudiants, sont-ils satisfaits du fait que c’est le Bauhaus ou est-ce que ce nom a de la valeur seulement de part sa notoriété dans le monde entier ? Comment allons-nous étudier, vivre ou construire nos villes à l’avenir ? Et ce sont les dessins que vous voyez à la fenêtre ou ici sur le papier. Les gens laissent leurs opinions ici, certaines sont très drôles. Il est très important qu’il y ait un peu d’humour car on ne peut pas parler de ces sujets, qui sont parfois tabous, de manière sérieuse. Parce qu’on ne peut pas parler d’un sujet sans penser à cinq autres sujets simultanément et parfois, quand on a déjà commencé à faire un dessin ou à avoir une conversation, on peut se perdre. Et c’est intéressant de voir ce qui se passe dans cette Tiny House depuis que nous sommes ici. Je pense que c’est bien que vous ayez l’espace et le temps pour échanger avec les autres. Des fois, il y a des gens ou des groupes de gens de Dessau et des étudiants qui viennent ici, pas tout le monde mais la plupart d’entre eux font des dessins, juste pour laisser une trace ici. Et si vous me demandez ce qu’est cet endroit, cette Tiny House, je dirais que j’y vois de nombreux aspects, parce que c’est le centenaire. Elle a des côtés positifs, elle a des côtés négatifs, elle a toutes sortes de choses. Mais ce sont les éléments que la vie construit et il est important qu’il y ait tout cela, et que les gens puissent s’exprimer. Ils n’ont pas à aimer, ils n’ont pas à détester, mais ils ont le droit d’en faire ce qu’ils veulent. Et c’est ce qui est important dans ces dessins et dans cette pièce.
Arlette Ndakoze: Cela correspond à ce que vous avez dit précédemment, à savoir que vous ne voulez pas vivre dans un monde où une personne peut dire : ma créativité compte plus que la vôtre. Que pensez-vous de ce monde où vous dites que tout se passe dans le présent ? Comment nous sentons-nous maintenant ? Qu’est-ce que vous sentez que vous portez en vous dans cette période ?
Lambert Mousseka: Je suis très heureux parce que beaucoup d’autres personnes pensent de la même façon que moi. Je dis que nous sommes une génération différente, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie, et que nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs que les générations précédentes. Nous voulons bien nous entendre entre nous. Non seulement les Européens doivent avoir le privilège de voyager partout mais les autres aussi. C’est le genre de monde que nous avons hérité des puissances coloniales. Ce que nous avons appris à l’école au Congo, c’est que nous sommes belges, nous sommes gaulois, germaniques, espagnols, etc. Mais ensuite, quand je me rends à l’ambassade pour demander mon visa juste pour voir la terre de mes prétendus ancêtres, je n’arrive pas à en avoir un. C’est de la merde. C’est scandaleux, ce n’est pas le monde que nous souhaitons. Si mes amis européens veulent voyager avec moi au Congo, ils devraient avoir la permission de venir, mais ceux du Congo devraient également être autorisés à venir ici. Aujourd’hui, il existe une zone sans visa du Congo à la Chine. Pourquoi cela n’existe-t-il pas ici, après 600 ans de coopération, de traite des êtres humains, puis d’esclavage et ensuite d’indépendance de l’Europe? Pourquoi n’existe-t-il pas cela avec l’Europe ? Car si l’on interdit aux gens de voyager, les gens viendront et voudront y rester. Mais s’ils savent qu’ils peuvent aller et venir et revenir comme ils le souhaitent, alors il y aura moins de problèmes. Personne ne veut vivre ici de toute façon, car il fait si froid. Je crois que nous appartenons à cette génération qui a besoin d’autre chose que des grèves et de la guerre. L’exemple de la France n’est peut-être pas le bon, mais je pense qu’il devrait y avoir des présidents plus jeunes dans tous les pays, ou que plusieurs pays plus forts devraient avoir des présidents plus jeunes de notre génération qui veulent vraiment faire une différence et laisser une bonne empreinte. Et je crois que la politique continuera à suivre ces tentatives artistiques car jusqu’à présent, ce sont seulement les artistes qui se sont battus pour cela. Par artistes, j’entends toutes les formes d’art. Et nous nous battons tous pour qu’il y ait une justice pour tous, mais la politique ne suit pas du tout et c’est vraiment dommage.
Arlette Ndakoze: Ma dernière question serait à propos de cet engagement des artistes – je voudrais parler de l’Espace Masolo, un espace que vous avez développé à Kinshasa avec d’autres artistes. Quel est cet espace et qu’est-ce qu’il y a été réalisé jusqu’à présent ?
Lambert Mousseka: L’Espace Masolo, même en tant que nom, a une très grande signification. Masolo signifie dialogue. Il s’agit d’un espace de dialogue. Pourquoi l’avons-nous appelé ainsi ? Parce que nous avons remarqué qu’il y a des milliers d’ONG au Congo. Je ne veux pas en parler maintenant parce que c’est encore un gros problème dans les pays dits en développement. Et la politique et tout le reste. Mais nous n’avons pas voulu suivre cette voie parce qu’elle n’aidait pas du tout le pays. En 2003, on s’est demandé comment créer une école, ou une façon d’enseigner différemment. Sans avoir une véritable école, sans avoir un bâtiment scolaire ou une autre forme impossible à réaliser. Nous avons donc eu l’idée de créer un espace où les artistes, les enfants des rues et les enfants soldats pourraient se rencontrer, non pas pour étudier ou s’instruire, mais pour passer du temps ensemble. Ces enfants des rues sont pour la plupart des enfants qui n’ont pas de famille ou dont le père et la mère sont morts à la guerre ou y sont pour une autre raison. Les enfants soldats aussi, tout le monde sait pourquoi ils existent. Nous avons fait venir ces gens dans l’espace et nous avons dit que nous ne voulons pas avoir de leçons au sens traditionnel, mais que ce temps que nous passons ensemble, devrait profiter à tout le monde. Par exemple, en faisant mon travail d’artiste et en vous y faisant participer, il se peut que je doive réparer mes instruments, et vous pouvez participer en apprenant à les réparer. Vous pouvez aussi essayer de jouer si vous aimez cela et il y a alors une autre façon pour vous d’apprendre. Si je suis acteur, je répète ma pièce et ensuite vous pouvez vous joindre à moi, vous pouvez aussi monter sur scène. Si je suis marionnettiste, alors je construis mes marionnettes et j’ai besoin de plusieurs personnes pour m’aider à construire et à jouer de très grandes marionnettes, car je ne peux pas moi-même jouer dix personnages. Lorsque les garçons et les filles sont déjà là, et qu’ils n’ont pas d’autre possibilité d’aller à l’école, n’ont pas de famille et ainsi de suite, alors ils peuvent simplement se joindre à nous. C’est ainsi qu’est né l’Espace Masolo. De 2003 à aujourd’hui, il fonctionne ainsi. Je peux dire que nous en sommes vraiment satisfaits. Je peux me déclarer le père de plusieurs enfants. Certains sont devenus des écrivains, d’autres des musiciens célèbres, d’autres encore des tailleurs ou des stylistes ou des designers célèbres. Et c’est un très grand honneur pour moi. Parce que nous l’avons fait sans s’attendre à quoi que ce soit. Je n’attends pas de nos amis qui apprennent chez nous qu’ils paient des frais en échange d’une quelconque forme d’éducation, il n’y a pas de frais chez nous. Il n’y a pas de favoritisme pour les enfants qui viennent chez nous. Certains sont même venus en Europe avec moi pour une tournée de théâtre ou de musique. Nous avons tous voyagé ensemble jusqu’ici et puis nous sommes tous revenus ensemble. De telles choses sont devenues possibles à l’Espace Masolo, parce que nous avons pris ce concept au sérieux et que nous avons construit quelque chose, à une époque où personne ne s’y attendait. Je suis fier parce que nous faisons cela depuis si longtemps et que nous sommes restés discrets parce que notre organisation n’est pas une ONG internationale. Il arrive souvent que l’on s’attende à être reconnu et que la Croix-Rouge ou l’UNICEF viennent un jour nous dire qu’ils nous donnent un million d’euros. Mais eux aussi s’attendent à des choses en retour, par exemple que nous écrivions le nom de leur grande ONG sur le mur et que nous disons qu’ils nous parrainent. Ensuite, des organisations telles que l’UNESCO, l’UNICEF, les Nations unies ou le ministère fédéral allemand interviendraient. Nous n’avons jamais fait cela et nous n’avons jamais voulu cela. Nous ne voulons pas cela non plus maintenant. C’est une petite structure et c’est pourquoi elle est encore vivante aujourd’hui. Et aussi, parce que chaque artiste qui veut soutenir l’Espace Masolo peut faire un don, quelle que soit sa forme. Tout le monde peut faire quelque chose. Cela signifie que certains artistes ont donné un euro, d’autres ont dit, qu'ils ne veulent pas donner de l’argent mais préfèrent aller sur place et faire un atelier avec des jeunes qui de cette façon pourront apprendre quelque chose de moi, et payer les frais de voyage avec l’argent à la place pour venir ici. D’autres disent qu’ils n’ont pas le temps mais font un don d’un instrument de musique. Et d’autres disent qu’ils n’ont pas d’argent mais donnent un espace pour faire une pièce de théâtre ou un concert. Et certains disent qu’ils n’ont rien mais qu’ils peuvent nous promouvoir si nous faisons un défilé de mode et c’est ainsi que nous avons travaillé depuis le début jusqu’à aujourd’hui.
La plupart du temps, parce que les enfants n’ont nulle part où aller pour avoir un repas chaud, nous organisons un déjeuner une fois par jour. Après avoir travaillé, nous avons tous une pause déjeuner où nous pouvons manger ensemble. Il s’agit de faire quelque chose ensemble. Nous n’appelons pas cela un atelier ou quelque chose de ce genre. Nous faisons simplement quelque chose ensemble. Ils peuvent prendre une douche, laver leurs vêtements, puis retourner à leur lieu de séjour plus tard dans l’après-midi.
Comment commencer ? Où sont les limites ?
Une conversation avec Van Bo LeMentzel
Comment faire tournoyer les triangles ? Comment élargir les angles ? Comment changer les constructions ? De l’oppression à... la traversée, à... l’ouverture, à... la liberté.
Une discussion, une réflexion, et une conversation, entre : Van Bo Le Mentzel, architecte de la Tiny House « Wohnmaschine », Anna Jäger, et Arlette-Louise Ndakoze, toutes deux membres de l’espace artistique S A V V Y Contemporary.
Van Bo Le-Mentzel: Si vous arrosez le sol avec un arrosoir et que vous y croyez, vous ne pourrez pas manger une pomme tout de suite, mais à un certain moment il y aura un arbre et puis il y aura plusieurs arbres et puis il y aura des branches et des feuilles et puis il y aura une ombre fraîche et à un certain moment, il y aura des fruits et puis vous pourrez manger des pommes. Mais jusqu’à ce moment là, beaucoup de choses dont vous profitez ont été créées.
Janvier 2019 Un voyage en train
Anna Jäger: Et c’est très bien, bien sûr, mais cette attitude est également requise sur d’autres aspects critiques. Je comprends également votre point de vue, partant de ce qu’on disait en Allemagne de l’Est « Entrer dans l’organisation pour la perturber de l’intérieur » pour entrer littéralement dans ces moments que vous trouvez critiques, et essayer d’être un modèle.
Un appartement sur roues. Une « Wohnmaschine ». Machine à vivre.
Une conférence de presse de Spinning Triangles. Nous faisons tournoyer des triangles, en pensant des cercles, en pensant en dehors du carré. Quittant le carré de 15m². 15 jours de non-honte. 15 jours de non-gloire. Infâme. Retour à la machine sur roues. Un voyage en train. Des pensées qui s’agitent. De la vie en commun. Communauté – mais comment, d’où ? Comment commencer ? Où sont les limites ? S A V V Y Contemporary. En voyage. Des triangles qui tournoient.
Anna Jäger: Pour que, là où vous êtes critique, vous vous engagiez réellement, pour être une sorte de modèle. Pour nous, pour moi personnellement, aussi chez S A V V Y, et c’est aussi quelque chose dont nous discutons beaucoup. De toute façon, Il n’y a pas de bon argent, mais nous en sommes toujours dépendants parce que nous vivons dans ce système et si nous voulons travailler, nous ne pouvons pas le contourner. Mais où est la limite ? Accepteriez-vous de l’argent d’un fournisseur d’arme ? Dans le cas de la Fondation Ikea, le fait est non seulement qu’il s’agit d’une grande entreprise, mais aussi que le fondateur était un nazi. La question serait donc la suivante: de qui acceptez-vous de l’argent et où posez-vous la limite? Et je pense que cela fait aussi partie d’un comportement responsable. Et bien sûr, si vous regardez attentivement n’importe où, vous trouverez toujours un problème. Mais comment pouvons-nous critiquer les structures et vivre en tant que personnes responsables ?
Van Bo Le Mentzel: Bien sûr, vous ne pouvez pas posséder de pensées, les pensées sont libres et ont toujours été libres et vous devez vous battre pour les garder libres ! Je sais, avec les artistes et les photographes et ainsi de suite, cela n’a pas beaucoup de sens de parler de cela, parce que c’est ce de quoi ils vivent. Donc, bien sûr, ce serait stupide, si leur travail était librement accessible, sans droit d’auteur. Sur un plan fondamental, cependant, je crois qu’il est bon que des choses comme les pensées, les nuages, l’air, la terre, l’eau, le CO2, l’oxygène, soient gratuits et que personne n’ait le droit de les posséder. J’ai vu des expositions à Nimègue en Hollande, où mes maisons étaient présentées et je ne le savais même pas. Ce n’est que plus tard que j’ai découvert, par pur hasard.
Avoir des expositions dans tant de pays sans même le savoir, c’est super bizarre. D’une certaine manière, c’est aussi une bonne chose, parce que ce qui se cache derrière, c’est l’expérience de ce qu’est réellement la propriété intellectuelle et si elle existe vraiment. Pouvez-vous vraiment posséder la culture comme le fait la Prusse ? Les biens culturels prussiens, pour ainsi dire [traduction littérale de Preußischer Kulturbesitz, la Fondation du patrimoine culturel prussien]. Pouvez-vous posséder des pensées ? Les gens qui n’ont même pas besoin d’accéder à mon travail gratuitement, ils l’obtiennent juste en cadeau.
Arlette Ndakoze: C’est exactement là que je me demande si ce n’est pas un point critique parce que, d’après ce que j’ai compris, Tiny House est censé présenter une autre forme de vie et exister publiquement et non comme une propriété. Le profit de ces entreprises repose précisément sur le fait qu’elles s’approprient des espaces et les privatisent. Pensant à Tiny Houses ; comment le projet est-il conçu, est-ce que tout le monde peut l’utiliser, comme une forme de partage ou est-ce que quelqu’un en est propriétaire au final? Comme nous vivons dans un monde qui est très affecté par ces structures, comment est-il possible que des personnes ayant moins d’argent et de pouvoir et moins d’accès à ces structures puissent en faire partie. Comment peuvent-elles le revendiquer et l’intégrer à leur vie?
Van Bo Le Mentzel: J’aimerais donner un exemple de la façon dont je pense à ce sujet et de la façon de changer les choses. 40 000 euros pour la réalisation de la « Wohnmaschine », machine à vivre, ont été versés par la fondation Ikea. Je sais que d’autres associations ou ONG refusent l’argent d’Ikea. Une fois, j’ai fait quelque chose avec le ZK/U [Centre pour l’art et l’urbanisme]. Ils ont clairement dit non, nous ne prenons pas l’argent de ces firmes, nous ne le faisons tout simplement pas. On ne peut pas faire ça pour des raisons morales.
On peut me voir dans une publicité Volkswagen et nous avons déjà loué des Tiny House à Bauhaus [un hypermarché du bricolage allemand] pour de l’argent. Nous, ou moi, passons également des accords avec des entreprises. Je travaille également pour des entreprises à l’heure actuelle. Dans les premières années, je refusais d’accepter de l’argent de compagnies ou de personnes que je croyais mauvaises. Maintenant, j’y pense différemment. Je ne pense pas qu’Ikea soit mauvais ou Starbucks ou Volkswagen. Ce n’est pas Ikea ou ses managers qui sont mauvais. Ce ne sont pas les policiers de Dessau qui sont mauvais, c’est le système, c’est la structure qui est mauvaise. Je dirais qu’une structure de haine est mauvaise, une structure de malveillance est mauvaise, une structure de mensonges est mauvaise, de persistance, qui n’oubli pas. Et si vous voulez changer les forces de police de Dessau, d’Ikea, de Starbucks, de la Fondation Bertelsmann et de Volkswagen, quel que soit le nom de tous ceux avec qui nous travaillons. Je peux, bien sûr, dire que je vais vous boycotter. Je n’achèterai pas vos produits, ou je ne vous parlerai pas, ou je vous insulterai, ou je protesterai contre vous. Ce serait aussi une façon de réaliser quelque chose. Cela peut aussi mener à quelque chose, comme vous pouvez le voir dans les manifestations en France. Les gilets jaunes, qui font des demandes et puis ils obtiennent aussi une réponse, ce n’est pas tout à fait sans conséquence.
Mais mon chemin est différent en ce moment. Bien que je ne sois pas sur un pied d’égalité avec les grands patrons d’entreprises, j’essaie toujours d’être un modèle. Je leur dis « regardez ça ». Bien sûr, si quelqu’un prend mon design et essaie d’en faire une affaire, je pense au début que c’est un peu stupide. Pourquoi ne me demande-t-il pas, ou pourquoi ne m’implique-t-il pas, ou pourquoi ne partage-t-il pas. Mais si vous êtes généreux, et j’ai appris cela au cours des cinq dernières années, les choses s’arrangent pour le mieux.
Tout a commencé avec S A V V Y, en fait avec Bonaventure, il a été le premier à être généreux. Je pense que c’était deux mois après avoir inventé le mobilier Hartz IV. Le mobilier Hartz IV a été le premier grand projet que j’ai rendu public. Je pense qu’il était relativement tôt, environ deux mois après cela, il m’a appelé chez moi et m’a dit ; c’est intéressant et j’aimerais faire une exposition avec vous. Il croyait en moi et il n’avait pas beaucoup d’argent pour le financer lui-même, mais il a rendu possible de le présenter à un public. C’était en 2012, non, c’était en 2010, c’était vraiment au début, au tout début de ma carrière de designer.
Anna Jäger: Et de la carrière de S A V V Y aussi.
Van Bo Le-Mentzel: Oui, exactement, ce furent les débuts de Bonaventure, de son travail de conservateur et aussi de mon travail de création. A titre d’exemple, une société en Autriche, Blum, m’a donné 10.000 euros, comme ça. Je me suis demandé pourquoi, ce qui se cache derrière, s’il y avait une manigance ou quelque chose comme ça. « Non », disaient-ils, « nous avons écouté l’un de vos exposés et je suis moi-même un réfugié », a dit l’un d’eux, qui travaille au service des ventes, « votre présentation m’a tellement touchée que je voulais vous soutenir. » Dans le passé, des entreprises comme Siemens ou peut importe leur nom, étaient aussi des mécènes et soutenaient les artistes. Ils ont dit que « 10.000 euros ne nous font pas de mal, ce n’est pas beaucoup d’argent pour notre entreprise et vous en avez plus besoin, alors prenez-les ». J’étais surpris, et j’ai commencé à m’intéresser à cette entreprise. Ils font des charnières, entre autres aussi pour Ikea. Si vous connaissez ces armoires où il suffit de pousser pour qu’elles s’ouvrent, c’est Blum. Il n’y a que deux entreprises Blum et Häfele, elles sont leaders sur le marché. Et puis j’ai jeté un coup d’œil à l’usine. Je veux préciser que c’était presque le début d’une amitié avec cette personne qui travaillait au service des ventes. Au bout du compte, c’est partout pareil, ce sont les gens qui comptent. Et c’est bien qu’il y ait quelqu’un comme ça, qui a un passé de réfugié et qui essaie de faire quelque chose à sa manière dans une entreprise. Même si la fabrication de charnières n’est peut-être pas la chose la plus pacifique au monde.s a refugee background and is trying to do something in his own way. Even if making hinges is perhaps not the most peacemaking thing in the world.
Anna Jäger: Vous venez de dire deux choses, la deuxième partie fait référence à ce que vous avez dit plus tôt. J’aimerais parler de ce sujet dans plus de détails. Je pense qu’il est vraiment important de regarder les structures, vraiment super important. Mais aucune structure n’existe sans les gens et je pense que cela fait actuellement partie d’une stratégie qui est utilisée, qui serait celle d’enlever à ces gens la peur d’être attaqués ou critiqués à cause de n’importe quel type de grief social. Et je comprends cela dans une certaine mesure, mais pour le moment, cela va trop loin pour moi. Parce que chaque personne, dans n’importe quelle structure, a des responsabilités. Et cela ne signifie pas qu’ils sont fondamentalement mauvais. Ils peuvent être très gentils et faire des dons et du travail bénévole, mais le fait qu’ils agissent de manière irresponsable dans certaines situations ou qu’ils agissent avec une certaine moralité qui les lie personnellement à un certain système ou à une certaine structure peut poser problème. Et je pense que c’est important. Cela n’a pas seulement de l’importance dans les cas très clairs d’injustice, découverts avec le recul. En fin de compte, ces choses arrivent toujours avec du recul. Mais il est aussi important de penser à eux dans le moment présent. Et si je travaille dans un cadre particulier, je pense que je devrais toujours me poser la question : comment me comporter, quelles sont mes réactions, quelle est ma conviction morale? C’est un domaine très difficile. Je ne veux même pas dire que je sais comment le faire ou ce qui est juste, mais je pense que c’est très important. Et c’est ce que vous venez de dire, il y a une seule personne dans l’entreprise qui a été inspirée par vous, qui a écouté, qui a joint les histoires, qui a eu de l’empathie.
À propos de Banka, Groupe de recherches sur le design Kinshasa
Jean KambaConcepts et pratiques hérités de la colonisation continuent, inconsciemment, à constituer un boulet aux pieds d’un grand nombre. Il faut donc une « archéologie du langage » qui pourrait provoquée ce qui est nécessaire pour le développement d’une vision décolonisée dans les pratiques culturelles et artistiques sur ce continent et ailleurs.
Il est temps, surtout pour les Africain·e·s, de se ressaisir et de questionner tout ce qu’il y a autour de nous. Que veut-ce dire d’embrasser la « modernité » dans un contexte où la colonisation est ancrée ? Revisiter cette notion s’avère obligatoire.
Ignorer la nécessité contemporaine de requestionner le passé pour envisager l’avenir serait comme marcher tête baissée ; réalisant ce que l’oppresseur souhaite. Ce serait d'écouter la voix intériorisée de ceux qui ont semé notre chemin d’embuches.
Banka est un concept, un groupe de chercheurs et pratiquants d’art, majoritairement kinois mais n’excluant pas d’autres citoyens du monde. Cette dénomination est issue du langage courant de Kinshasa où l’on dit : « Kinshasa mboka banka » ; littéralement traduit : « Kinshasa la terre des avertis ».
« Ba » exprime le pluriel, et « nka », veut dire « averti ». D’où Banka s’avère être le groupe des avertis. Avertis en termes de ce qu’ils sont, tout en cherchant à avertir la communauté sur leurs richesses et en faisant des propositions où aller d’ici.
Actuellement, ce groupe est constitué d’un poète et critique d’art, d’un opérateur culturel et artiste designer, d’un artiste visuel, d’une modéliste et d’un architecte.
Nous inscrivons nos recherches dans l’optique de la révélation des richesses cachées de notre pays et la cassure des stéréotypes qui gangrènent la société provocant un complexe d’infériorité. Ces maux sont à observer dans le comportement d’un grand nombre via leurs langages tant verbaux que corporels. Ainsi, ce travail de délogement du cheval de Troie s’avère tant ardu mais pas impossible à accomplir.
Triangles Tournoyants
Dans le contexte du projet Triangles Tournoyants, nous avons axé la majorité de nos recherches dans une optique des remises en question et des questionnements sur quelques pratiques qui régulent la quotidienneté de l’humanité, ce dans un contexte congolais. Un chantier vaste, qui requiert assez de ressources, qui ici n’est exploré qu’en partie ; travail qui se résume en ébauche augurant des fouilles approfondies dans les jours à venir.
Jonathan Bongi : Architecture coloniale, architecture vernaculaire, écosystème et habitat
De son côté, le designer Jonathan Bongi s’est basé sur l’époque actuelle où l’urbanisation s’est accéléré et la demande d’habitation démultipliée, en pointant du doigt l’architecture vernaculaire, qui répond naturellement à une logique longue et progressive d’enracinement. De ce fait, il a fait constater que celle-ci a été délaissée au profit de la standardisation des techniques de constructions modernes qui a produit, en masse, de grands ensembles et maisons individuelles identiques sans personnalités. En conséquence de cela, l’image des matériaux traditionnels, associés à la pauvreté et l’archaïsme, a été dévaluée dans l’imaginaire commun, faisant ainsi baisser le nombre d’artisans traditionnels.
Jonathan Bongi (*1992, Kinshasa, R. D. Congo) est un architecte et associé junior chez Line Studio (Tunis). Il a fréquenté l’Institut Supérieure d’Architecture et Urbanisme (I.S.A.U.) ainsi que l’Université Panafricaine du Congo (U.Pa.C.), puis a été diplômé en 2014. À sa sortie de l’école d’architecture, il a intégré à l’équipe MASS Design Group (Rwanda), comme assistant du chef de chantier pour la réalisation du projet Ilima Primary School dans la province de l’Équateur. Depuis, il a cultivé cette partie architecturale visant l’amélioration des matériaux locaux en construction. Cela est ce qui lui a permis de prendre part à des projets ayant les mêmes approches. Son envie d’exploration et de découverte des nouvelles techniques de construction, l’ont conduit vers d’autres régions du continent Africain, dont actuellement la partie nord, plus précisément la zone maghrébine. Il travaille actuellement à l’écriture d’un mémoire sur les méthodes des constructions tunisiennes.
Jean Kamba : Dessein et design
Jean Kamba a, de son côté, basé ses recherches sur les lignes définitionnelles con- cernant la légitimité qui couvre celui qui nomme ou celui qui détient le bâton à désigner jusqu’aujourd’hui, après une gymnastique scientifique mettant en exergue les liens entre dessein et design ; tout en étant dans une logique de la légitimation des pratiques plastiques et fonctionnelles africaines. En ce qui concerne le concept « Design », il s’est demandé si besoin il y a quant à chercher des correspondances entre lui et une quelconque pratique conceptuelle, plastique et fonctionnelle en Afrique. Faut-il continuer à avoir pour modèle, ce dont les livres et « savants » d’un autre contexte que celui d’Afrique ont défini selon leurs perceptions biaisées et quelques fois partisanes ?
Jean Kamba vit et travaille à Kinshasa. Licencié en sciences de l’information et de la communication à l’Université Pédagogique Nationale de Kinshasa (UPN), à la faculté des Lettres et Sciences humaines, depuis 2012. Écrivain, poète, journaliste, et critique d’art, assistant de recherche à l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa ; Il organise aussi des expositions. Il œuvre dans le management des projets artistiques axés sur l’art contemporain. Un des membres de Kinshasa-Africa cluster d’Another Road Map School, il est consultant auprès du collectif d’artistes Solidarité des Artistes pour le Développement Intégral (SADI) et du centre d’art Waza.
Rita Mayala : Le tricot et la broderie dans le design
Rita Mayala, dans le domaine de la mode, a fait observer que le design, en R. D. Congo, ne se concentre pas sur la technologie de la production de masse. Elle a orienté ses recherches vers le design textile dans la broderie et dans la technique du tricotage, tout en tablant sur la possibilité d’innover et de proposer de nouvelles visions teinté de particularité.
Rita Mayala est une jeune styliste congolaise qui vit et travaille à Kinshasa. Elle est passionnée de mode et d’art (broderie, musique …). Après son bac, elle a poursuit des études de mode durant cinq ans à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers (ISAM), à Kinshasa et a obtenu le titre de styliste de mode en 2016. Elle tient aujourd’hui sa maison de couture MOSALA Collection spécialisée en maille (tricot) et en broderie tricotée, ouverte depuis juillet 2017. Elle a comme projet de lancer une ligne de vêtements prêt-à-porter brodés en maille.
Elie Mbansing : Cinq courts métrages tournoyants
Elie Mbansing, artiste visuel et vidéaste, s’est basé sur une catégorie d’acteurs sociaux avec comme fil rouge, entre ces derniers, la créativité dans la liberté. Il a mis en exergue, via de courtes vidéos, la transversalité et la cassure de canons classiques qui règnent dans le domaine de l’habillement, des croyances et de la foi, de la musique, et de la créativité. Avec les objets crées par ces acteurs, fonctionnels de surcroît, il s’est dégagé l’ossature d’une institutionnalisation ou des lieux parallèles de transmission des connaissances peu habituels, ne dépendant que d’un contexte non intéressé, au départ, par le lucre mais plutôt par le souci de réinventer le quotidien en l’imposant une autre manière de s’habiller, de jouer à la musique et ainsi de suite.
Elie Mbansing (*1992, Bandundu, R. D. Congo) a entamé, en 2010–2011, ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Il s’y est inscrit en arts plastiques et graphiques, après un bref passage en formation de mécanique. Depuis 2012, à Kinshasa, il a créé et présidé Tosala Cinema, un collectif réunissant des jeunes artistes pluridisciplinaires pour promouvoir l’esprit entrepreneurial dans le domaine socioculturel congolais. Pour s'adapter à la spécificité de chaque projet artistique, il développe des méthodes de travail qui établissent un dialogue entre les outils qu'il utilise et sa pratique. Avec un regard direct sur les rapports de force de la modernité dans la vie quotidienne des Kinois, son œuvre immortalise des moments de la vie à Kinshasa. Il le fait principalement par le biais de films documentaires et expérimentaux.
Jean-Jacques Tankwey : Objets cultes, intemporels du quotidien : pouvoir et destin ?
Jean-Jaques Tankwey a basé son travail de recherche sur un échantillon d’objets du quotidien portant une importance capitale et même vitale. Il a porté son choix provisoire sur trois, parmi tant d’autres, dont le Lituka, le Nzete ya Fufu, Mutute et Nzete ya Liboka. Ce travail sous forme d’un répertoire a consisté à dégager les forces et valeurs physiques ainsi qu’intrinsèques qui font que ces outils de ménage résistent au temps et aux influences culturelles fusant de parts et d’autres. Il s’est dégagé, après observation, que la force de l’omniprésence de ces outils de ménage réside dans la conservation des valeurs culinaires dans le chef de Congolais. Un travail de fouilles et de recherches, ayant comme cadres théoriques les sciences humaines telles que l’histoire, la sociologie, l’ethnologie. Ces matériaux lui permettent de dégager des théories pouvant l’aider à concevoir, en tant que designer, des créations qui pourront traverser le temps autant que ces objets.
Jean-Jacques Tankwey Mulut (aka Tankila) est un artiste designer et manager. Il s’intéresse à la création d’objets uniques, qui transcendent les générations jusqu’au point de devenir intemporels. Ses inspirations émanent des cultures du monde, ainsi que des beaux-arts. Dans son travail, il essaie des combinaisons entre l’art et le design ainsi que les nouvelles technologies. Par sa volonté permanente de recherche et de créativité, il focalise son approche en tant que créateur. Il n’est pas dans le design définitionnel, mais réfléchit plutôt sur ce que sera le monde dans le futur, sans omettre les questions environnementales et celles du patrimoine matériel et immatériel. Tankila travaille principalement le métal qu’il associe à d’autres matériaux tels que le verre. Des fois, il détourne les objets du quotidien afin de leurs donner une seconde vie. En 2014, il a participé au workshop De l’universel au particulier, animé par le designer belge Xavier Lust. En 2016, il réalise son premier sofa nommé C-vi. En 2017, son projet Canapé connecté kk2050 est sélectionné et présenté à l’exposition Kinshasa 2050 à l’Institut Français de Kinshasa.
L’Academie des Beaux-Arts de Kinshasa, une institution artistique pluridisciplinaire et transversale
Professeur Kalama Akulez Henri, PhD.Directeur général de l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa
La vision éducative de l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa (ABA-KIN) n'est pas loin de l’esprit de Bauhaus dont on célèbre le centenaire cette année. Depuis sa création, notre institution a toujours été un lieu de vie, d’échange et de croisement entre l’art, l’artisanat, le design et l’industrie culturelle. Pour promouvoir une formation adaptée aux nécessités de notre temps, nos étudiants sont formés de manière à pouvoir penser, concevoir, créer l’art en se confrontant aux défis qui sont les leurs maintenant de manière à anticiper le « futur ».
Créée en 1943, l’ABA-KIN dispose aujourd’hui de sept départements regroupés en deux sections : les Arts Plastiques (la sculpture, la céramique, la peinture, le métal et la conservation & restauration des œuvres d’art) et les Arts Graphiques (l’Architecture d’Intérieur et la Communication Visuelle). A partir de l’année 2019–2020, nous rendrons opérationnels les Départements de Design et de Photographie qui, jusqu’à présent, sont des cours enseignés à la section Arts Graphiques.
Cette redynamisation et diversification de nos filières d’étude en arts visuels est liée à l’urgence de la modernisation de l’ABA-KIN et à une forte demande sociale. Pour y répondre, il nous faut des infrastructures conséquentes en plus d’un personnel académique et scientifique très bien préparé. Car, comme institution d’enseignement supérieur et universitaire, nous devons offrir une formation susceptible de donner des compétences solides en formant à la fois à la recherche théorique (fondamentale) et à la recherche pratique (création) en vue de répondre aux besoins sociaux (développement) dans les domaines des arts visuels.
Collaborer avec SAVVY Contemporary constitue pour nous un moyen de développer un tel enseignement qui fait interagir l’école et la société. C’est dans ce cadre que nous avions accueilli le Forum « Spinning Triangles » à l’occasion du centenaire de la fondation du Bauhaus pour parler de notre parcours dans le domaine du design. Cette initiative a renforcé nos différents projets de réforme académique qui préconisent une école d’art adaptée aux nécessités de notre temps où on œuvre de manière à rencontrer les problèmes planétaires et les faire vibrer dans notre création comme l’écho du souci des hommes.
C’est dans cette orientation que l’ABA-KIN est dynamique et se veut être « prospective » pour répondre aux exigences du renouvellement permanent de nos vies et construire des futurs. En explorant minutieusement notre présent, nous voulons créer une institution d’art compétitive qui est en mouvement avec l’ensemble du monde et fonctionne en pensant, en agissant pour un développement durable.
Cet engagement dans la « construction du futur » de nos sociétés est une œuvre collective. Pour cela, sur le plan scientifique, l’Académie offre une formation interdisciplinaire où les sciences humaines et sociales ont une place importante. Sur le plan technique et artistique, notre section des Arts Graphiques (Architecture Intérieure-Design et Communication Visuelle), bénéficie d’un cursus qui intègre la dimension esthétique aux techniques architecturales et communicationnelles et cherche toujours une adaptation aux nécessités du monde industriel de notre société. cette Section s’est révélée être une véritable école du design qui forme des concepteurs capables de trouver une harmonie entre les arts plastiques et les arts graphiques (arts décoratifs, design, architecture d’intérieur, typographie, photographie, …) selon les besoins réels de la société.
Pour faire de l’ABA-KIN une école artistique moderne au cœur de l’Afrique centrale, la quête de l’excellence est le leitmotiv dans notre participation à la « construction mondiale des futurs propres » pour que nous nous sentions réellement chez nous en habitant nos villes, nos rues, nos maisons.
Spinning Triangles
L’atelier que Monsieur Van Bo Le Mentzel a animé cette année à ABA-KIN lors du Forum « Spinning Triangles », a particulièrement sensibilisé nos étudiant·e·s en Architecture Intérieur-Design à cette urgence en termes d’urbanisme résidentiel et édifices de travail. Son savoir (faire) nous a sans doute appelé à revisiter, par exemple, le cours de l’histoire de l’architecture, à repenser les pratiques architecturales modernes pour développer de nouvelles stratégies dans le domaine de l’immobilier.
Il n’y a aucun doute que notre rencontre avec le Laboratoire SAVVY Contemporary a été, pour nous, une belle opportunité dans notre réflexion de la création d’un Département de Design.
Mandombe : Une écriture comme approche épistémologique pour la décolonisation du savoir
Résumé d'une conférence et d'un atelierSimon Malueki Matuasilua
Ce résumé fait référence à une conférence et à un atelier d'accompagnement dans le chapitre berlinois de Triangles Tournoyants. En animant ce sujet lié à l’écriture Mandombe, le conférencier a voulu, non seulement faire découvrir cette nouvelle science aux participants et / ou étudiants de l’école du design de S A V V Y Contemporary, mais aussi scruter et offrir un geste de renversement scientifique et artistique, un défi du modèle éducatif qui incarne et crie à la postulation de Boaventura de Sousa Santos selon laquelle « une autre connaissance est possible », crédo également de l’espace d’échanges, S A V V Y Contemporary, selon leur concept¹.
Rappel théorique du concept d’écriture et du design
La plus ancienne écriture (hiéroglyphe) de l’humanité est l’œuvre de Thot qui fut un Anou (« nègre » en Kémit). Les noirs ayant été désappropriés ou dépossédés de cette écriture qui a donné, au fil des années, naissance à d’autres formes d’écriture, le créateur vient encore de leur montrer sa face en Afrique en leur révélant l’écriture Mandombe. Dès lors, ses traces demeurent encore peu connues. Car, comme le note Tshikaya U’Tamsi : « L’écriture est le miroir où se peigne toute la mentalité, toutes les structures culturelles, philosophiques, et même économiques »².
Le design, de son coté, présente les atouts et les impacts diversifiés selon les domaines : architecture, art plastique, coupe-couture, mécanique, etc. C’est autant dire qu’il est une pratique qui est peu aisée à délimiter. D’après Victor Papanek, cité par Antoine Le Pessec (2014)³, le design est inhérent à toute activité humaine aussi longtemps que l’acte et les moyens mis en œuvre visent à atteindre un objectif souhaitable et identifiable. Le design, c’est ce que les êtres humains font, mais pour bien l’apprécier, Milton Glaser précise qu’ « il y a trois réponses possibles à une pièce de design: oui, non et wow! Wow est la réaction que vous devez rechercher »⁴.
Ainsi, en développant ce sujet, nous avons voulu que les étudiants de l’école de design de S A V V Y Contemporary se fassent une idée exacte sur l’écriture Mandombe, en dénicher sa pertinence et sa richesse à travers quelques design choisis parmi une multitude d’œuvres réalisées par les Mandombistes comme résultats de recherche. Nous avons aussi voulu susciter l’intérêt pour le Mandombe afin de motiver chaque participant à l’apprendre.
Ce qu’il faut savoir de l’écriture Mandombe
L’écriture Mandombe a été inspirée, en 1978, à Mbanza-Ngungu, par Papa Simon Kimbangu au jeune congolais de 21 ans appelé David Wabeladio Payi. Elle tire son point de départ des éléments qui ont la forme du chiffre 5 et 2 découverts sur la mur de briques et appelés respectivement Pakundung U (5) et Pellekete (2). Elle se définit comme écriture des noirs, pour les noirs, à la manière des noirs. Elle est subdivisée en trois modules: Masono ou la graphie (savoir lire et écrire un texte en Mandombe), Kimbangula ou l’art (initie à la manipulation des symboles de Mandombe) et Kimazayi ou la science (permettant à chaque apprenant d’appliquer le Mandombe dans sa spécialité) Mandombe s’écrit de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut. Mandombe ne se transcrit pas en alphabet, elle est syllabique et s’adapte aux langues africaines.⁵ On se sert des principes de miroir, d’optique, de projection, de lissage, etc en écriture Mandombe. Elle est composé de 700 caractères repartis dans les sous-groupes que voici: mvuala (consonnables), bisimba (voyelles), mazita (syllabes), bisinsu (signes divers).
Ainsi, les mvuala associées aux bisimba nous donnent les mazita dont nous présentons quelques-unes ci-dessous.
Bien que destinée aux noirs, toute personne peut se servir de l’écriture Mandombe pour communiquer, comme c’est le cas avec l’écriture romaine, chinoise, arabe, gréco-latine, etc.
L’écriture Mandombe et le design
L’écriture Mandombe a le pouvoir de produire le design dans bien des domaines. Tout ceci se fait sans emprunt aux autres cultures ou systèmes de pensées. Voilà qui nous fait dire que le Mandombe est une approche épistémologique mise à la portée de l’Afrique pour la décolonisation du savoir.
a) Masque Mandombe b) Robot Mandombe c) Mécanique Mandombe d) Ville selon les normes
L’écriture Mandombe présente une nouvelle manière d’appréhender la science et de modéliser les problèmes. Singulièrement, elle peut permettre à l’Afrique de progresser et redevenir autonome scientifiquement et technologiquement.
Au-delà de cette réalité, tout le monde, sans distinction de race, peut se servir de l’écriture Mandombe pour se communiquer par écrit.
École / Non-école – Quelle école ?
Vers un espace de partage des savoirs
Compte rendu d'une discussion collective
Au cours du chapitre de Kinshasa de Triangles Tournoyants (06.04.–14.04.2019), une plate-forme d’échange pour le transfert de connaissances entre plusieurs acteurs du « sud global » a été créée. Au cours d’un symposium, les participants ont débattu des statu quo, remis en question des solutions, parlé de succès, d’échecs, d’idées, de possibilités et d’impossibilités, tout en passant de présentations à des discussions, de la musique et des spectacles. Trois ateliers ont ouvert la voix à d’autres dialogues, où les conditions du « maintenant », la pratique du design et les formats pédagogiques ont été non seulement réfléchis mais ont aussi, ou ont tenté, d’être remodelés par la pratique. Le symposium et les ateliers ont été suivis de cycles de discussion au cours desquels un concept viable d’école de design a été remis en question et débattu.
Pour donner une impression de la première et plus vaste réunion, nous avons décidé de publier des parties du protocole. Les notes ont été éditées par la suite, principalement pour faciliter la compréhension du contexte.
19 avril 2019, Kinshasa, Barumbu
09:00–13:00
Note
La réunion a commencé de manière informelle avec seulement quelques participants. Ce début n’a pas été entièrement rapporté par écrit. Ce premier échange a conduit à des questions sur le savoir, sur ce que l’on peut appeler le savoir et sur les différents concepts de « vérité », ainsi qu’à des opinions sur les savoirs « traditionnelles » et les connaissances dites « scientifiques » et leur façon de revendiquer le concept de « vérité ».
● Coco Lomami : il n’y a pas d’alphabet lingala, nous n’avions pas d’alphabet avant l’arrivée des Portugais
● Lambert Mousseka : il y avait déjà beaucoup de systèmes d’écriture en Afrique avant le colonialisme, également dans ce qui est maintenant la R. D. Congo. Il évoque les différents peuples qui vivent dans le bassin du Congo, ainsi que dans le royaume du Kongo, et que les Portugais ont rencontrés à leur arrivée au XVe siècle. Il dit que le système d’écriture latine n’a été imposé que plus tard. Nzinga Mbemba (ou le roi Afonso I, c. 1456–1542 ou 1543) a communiqué par écrit avec le Portugal. Mais il y avait beaucoup d’autres systèmes en place.
● Nous faisons le point : toute écriture n’est pas nécessairement faite dans un alphabet, mais peut néanmoins être un système d’écriture.
● Jonathan Bongi : parle des Berbères qui font la promotion de leur langue. La compare à la dite impossibilité pour le lingala d’exprimer certaines choses (commentaire sur la critique de Coco Lomami plus haut), et fait référence à l’exposé de Saki Mafundikwa où celui-ci mentionne la divination et les tablettes de mémoire des Baluba. Ne pourrait-on pas en déduire un mot pour « disque dur » ? Si nous partons déjà du principe, ancré dans le colonialisme, qu’il n’y a pas de possibilités dans notre propre culture, nous ne trouverons pas les solutions que nous cherchons.
● Nous parlons de la non-présence de statues et autres objets rituels fonctionnels dans les ménages et de la peur générale à Kinshasa associée aux métiers traditionnels lorsqu’ils sont liés à des pratiques rituelles, diabolisées par les églises. Lambert attire notre attention sur la maison où nous nous trouvons en ce moment, pour la réunion. Elle appartient à une famille juive grecque et on y trouve une Mézouza sur chaque encadrement de porte. Les traditions des propriétaires sont dans la maison mais il ne se souvient pas d’avoir vu quelque chose de comparable dans un foyer congolais avec un objet lié aux traditions congolaises. D’autres sont d’accord. Il y a peut-être eu des objets rituels traditionnels utilisés comme décorations, mais même cela serait rare.
● Jonathan Bongi fait référence au lingala et au fait que le lingala parlé à Kinshasa ne peut être comparé au lingala d’où il vient, dont le vocabulaire est beaucoup plus vaste, car à Kinshasa la langue a été influencée par le français. Principalement parce que cette dernière était et est encore la langue de l’administration. Coco Lomami illustre cela en citant un passage de la Bible qui ne peut être traduit en lingala. Lambert souligne que cela est principalement dû à l’impossibilité de traduire un mot exactement en un autre. Vous ne pouvez pas traduire « boulanger » lorsque cette profession n’existait pas dans la culture et donc dans la langue dans laquelle vous voulez traduire le mot. Il en va de même dans l’autre sens. De nombreuses pratiques sont traduites par « sorcellerie », même si ce n’est pas ce qu’on entend dans la langue (il parle de Tshiluba), souvent il faudrait plutôt la traduire par « sagesse des ancêtres » par exemple.
● La discussion porte sur l’opposition entre la spiritualité et la science.
● Elsa : La science n’est pas synonyme de connaissance. La science n’apporte pas nécessairement la vérité. « Même en faisant des cases plus petites et plus détaillées, nous n’atteindrons pas un cercle parfait. La méthodologie scientifique aborde ce qui est peut-être la vérité mais ne peut jamais être vraiment la ‘vérité’ ».
● Coco : Dans la science, vous devez démontrer que votre proposition est valide pour la prouver. La médecine occidentale fonctionne.
● Lambert : L’erreur de la médecine occidentale est d’avoir déconnecté la science de la spiritualité. Imaginez combiner la science avec le savoir spirituel africain.
● Coco donne l’exemple de l’épilepsie, autrefois considérée comme une maladie mortelle mais qui peut parfois être traitée par la médecine occidentale aujourd’hui.
● Jonathan : Mais d’où vient finalement ce médicament, ne serait-ce pas également et simplement un savoir bien emballé qui existait déjà?
● Lambert donne l’exemple des Malewas (stands de nourriture dans la rue) et de la nourriture qui est servie dans les restaurants. Au final, il s’agit peut-être de la même nourriture, mais vous payez 100 fois plus parce qu’elle est présentée dans un meilleur emballage.
● Jonathan : parle d’un garçon de la province de l’Equateur (R. D. Congo), qu’il a rencontré en travaillant sur le projet de l’école Ilima, et qui a une grande connaissance des plantes médicinales et peut traiter de nombreuses maladies avec les plantes qu’il collecte dans la forêt.
● Tankwey donne l’exemple de sa fille qui a été guérie avec des remèdes à base de plantes lorsque la médecine occidentale a échoué. « Personne n’a le monopole de la connaissance. L’histoire nous apprend que jouer l’un contre l’autre n’aide pas. »
● Lambert : « Il n’y a pas une seule vérité, il y en a plusieurs, il n’y a pas un seul savoir mais plusieurs savoirs, tout dépend de l’endroit où l’on se trouve ».
Note
Au cours de cette discussion, d’autres personnes ont rejoint le rassemblement. Nous décidons alors de commencer officiellement la réunion.
● Introduction : Il s’agit de discuter d’une proposition, d’une vision pour un espace d’apprentissage qui pourrait trouver un moyen d’entrer en relation avec le monde et d’échanger des connaissances. En ce qui concerne la discussion précédente, nous pouvons nous demander ce que nous considérons comme un bon moyen d’améliorer nos relations avec le monde, car la voie qui s’impose actuellement ne le permet peut-être pas. Une fois qu’une vision ou une proposition devient plus claire, nous pouvons également réfléchir à sa forme structurelle.
● Grace Mujinga soulève la question de la durabilité de l’espace d’apprentissage, elle l’appelle « bureau d’études ».
● Elsa mentionne la discussion avec Cheick Diallo cinq jours plus tôt qui portait sur l’importance de partager les connaissances plutôt que de les garder pour soi.
● Lambert parle de ses expériences à l’Espace Masolo en rapport avec ce thème. Il faudrait peut-être décloisonner le poste d’enseignant, pour que les gens puissent proposer des projets. La documentation des activités est importante. Des recherches devraient également être menées.
● Lambert est contre la création d’un lieu physique pour l’école. Orakle Ngoy est d’accord.
● Lambert suggère que de cette façon, on pourrait aussi se rassembler au-delà de Kinshasa.
● Grace parle d’échange et du fait que l’enseignement et l’apprentissage vont dans les deux sens. Il devrait y avoir une grande différence avec le système académique en place dans lequel les professeurs monopolisent le savoir.
● Coco convient qu’un élément important est le partage des connaissances. Mais nous nous sommes également interrogés la dernière fois sur la manière de réunir les aspects formels et informels. Il parle de trois éléments : l’éducation, la production et la vente. Il déplore l’absence de micro-crédits pour les designers. Plutôt que de l’appeler « école », il préfère l’appeler centre d’échange, où l’un produit et les autres apprennent du processus de fabrication.
● Orakle suggère qu’il est important de travailler à partir de et avec le contexte dans lequel nous nous trouvons. Elle donne l’exemple du Goethe-Institut. Le Goethe-Institut est une immense institution mondiale. Ici, à Kinshasa, le bureau est très petit. Néanmoins, ils parviennent à réaliser de nombreux projets. Elle veut penser au-delà des institutions, donner la possibilité d’apprendre différemment, donner une liberté d’apprendre et de créer d’une manière qui convienne aux gens. Elle suggère qu’il devrait y avoir un bureau physique pour créer un point de référence pour les gens. À partir de là, des projets pourraient être réalisés dans toutes sortes d’endroits, dans tout le pays si cela est proposé. Le bureau pourrait être là pour prendre les idées des personnes intéressées et essayer de trouver des budgets pour cela.
● Lambert parle d’identifier où nous voudrions travailler mis à part Kinshasa. Tout est concentré à Kinshasa. C’est un problème. Dans les campagnes, les connaissances disparaissent. Les personnes qui travaillent le raphia, qui font de la céramique sans four électrique, les meubles, les textiles, etc.
● Orakle : D’autre part, il y a l’administration. Ce qui est un problème. Vous pouvez avoir une idée mais être tellement taxé par la police, etc. qui bloque et mange l’argent sans se soucier de votre idée, que la réalisation d’une idée devient quasi impossible.
● Lambert suggère que l’école fasse des recherches, de la documentation sous plusieurs formes et lance des discussions dans les campagnes, en dehors de la capitale. Cela pourrait prendre la forme de livres ou d’autres formats qui pourraient ensuite informer les gens. Cela pourrait créer un réseau.
● Tankwey suggère de travailler en réseau avec Lubumbashi par exemple comme point de référence, ce qui pourrait permettre de travailler davantage avec les lieux environnants.
● Une personne du public mentionne les différents centres culturels de Goma.
● Orakle suggère de donner accès à ce réseau à une seule personne plutôt qu’à plusieurs. Cette personne pourrait échanger ses connaissances ailleurs et les rapporter à l’école. Des appels ouverts aux jeunes artistes pourraient être une possibilité.
● Lambert parle de créer un bureau hors de Kinshasa pour décentraliser ces informations, et pour relier plus facilement les campagnes entre elles en dehors de la capitale, pour produire et être présent dans toutes ces campagnes comme bureaux de liaison. Il appelle cela « antennes ». Il en dessine une carte. Il pense à des expositions dans tous ces lieux. Plutôt que de toujours se relier à et se concentrer sur l’Europe.
● Tankwey : les institutions ont des problèmes. L’un est le problème de la mise en réseau avec d’autres espaces, l’autre est principalement financier. Peut-être que ce projet donnerait de la force aux institutions, il ne résoudra peut-être pas directement ce problème mais donnera au moins de la visibilité à ces questions en augmentant l’interaction.
● Coco : la décentralisation crée des contraintes, divise l’énergie. Il suggère de développer des philosophies scolaires en fonction de régions spécifiques.
● Orakle présente Beril Nzila, un opérateur culturel de Brazzaville, qu’elle a invité à la réunion.
● Beril parle de Brazzaville, et d’un projet spécifique dans lequel il s’est engagé. Son projet était davantage axé sur l’éducation dans l’industrie culturelle. Ce projet s’appelle UBK – Urban Brazzaville Kelasi en partenariat avec l’Université de Brazzaville. Il s’agit d’un projet de transmission des connaissances qui passe par les délégués. Il est d’accord avec Coco pour dire qu’il faut un noyau fort pour qu’un projet comme celui-ci fonctionne et ait un effet de transmission.
● Elsa propose de formuler une proposition forte, qui rende clair le but et la vision de l’école, afin qu’elle puisse devenir une sorte de noyau explosif.
● Lambert suggère de commencer par des questions : « Pourquoi une telle école à Kinshasa ? »
● Elsa : Et dans ce projet, qui a aussi cette envergure mondiale, on pourrait ajouter la question suivante, pourquoi serait-il nécessaire de diffuser les idées de l’école en dehors de Kinshasa?
● Coco : Une école de design existe déjà à l’Académie des Beaux-Arts mais ne produit pas d’entrepreneurs-designers. Peut-être que cela pourrait être un point clé. Ainsi, tout le monde ferait des propositions aux difficultés de la vie réelle ici et les gens se joindraient à eux. De cette façon, cela serait utile.
● Lumière Rumanya : tout le monde ne veut pas faire autant d’années d’études ou n’a pas nécessairement les moyens de payer les frais d’inscription à l’académie.
● Tankwey : à l’Académie des Beaux-Arts, il y a un cours d’architecture intérieure, le design se fait dans ce département, quel que soit son nom. Mais l’enseignement tourne autour de l’architecture intérieure. En même temps, il y a beaucoup de savoir-faire en matière de design et d’artisanat dans la population. Nous avons besoin d’une école de design car le savoir-faire existe déjà mais n’a pas de lieu de rencontre, il n’est pas vraiment reconnu, il n’est pas diffusé, ni vulgarisé.
● Orakle : il n’y a pas de véritable liberté de création et d’expression dans les institutions, il y a des hiérarchies entre ceux qui enseignent et ceux qui apprennent, si nous créons une nouvelle école, nous devrions offrir une plus grande liberté de création et de partage.
● Lambert : nous devrions parler de design de produits, pas seulement d’architecture. A propos des matériaux, etc.
● Tankwey : la pratique du design est importante. Elle englobe beaucoup de choses. Tant que la pratique a une fonction utilitaire, on peut l’appeler design. Céramique, communication visuelle ...
● Personne inconnue : l’académie des beaux-arts propose déjà de nombreux cours, vous devez choisir vous-même vos cours afin de développer vos compétences. Qu’il s’agisse de photographie ou d’autre chose. Il y a une différence entre ce que vous proposez et cette école : ce que vous proposez se limite au design.
● Lambert : nous devons faire attention aux mots qui nous limitent (école, enseignants, élèves, monsieur / madame).
● Gloire Maliani : le design peut être partout, le design est l’observation de notre environnement.
● Personne inconnue : qui a accès à ces écoles ? Est-ce que c’est ouvert à tous ? En termes d’âge par exemple ?
● Plusieurs voix affirment que c’est pour tout le monde
● Beril : ce n’est pas une école conventionnelle, où l’on préciserait exactement ce qu’il faut faire. Dans ce projet, vous êtes dans une dynamique imaginaire, et en même temps dans une démarche professionnelle. Le problème à Brazzaville est le même. À l’Académie des Beaux-Arts de cette ville, l’approche est conventionnelle. Un enfant créatif de, disons neuf ans, qui pourrait faire des créations incroyables, n’y aurait pas sa place. Mais il ou elle pourrait peut-être vraiment apporter quelque chose à la pratique du design, surtout si lui ou elle est associé(e) à des professionnels expérimentés. Mais ce n’est pas ce que les gens entendent par « design » pour le moment. Le design, pour les gens de la rue, pourrait signifier autre chose. Ce projet pourrait permettre une meilleure compréhension mutuelle et des créations intéressantes.
● Orakle : Il pourrait être intéressant de définir des objectifs et des buts et de les documenter, afin de pouvoir créer une base.
● Elsa : Ce serait formidable si nous pouvions nous mettre d’accord sur des éléments clés, peut-être des valeurs communes pour l’école, pour nous entendre sur ces objectifs. Nous pourrions trouver des alliés dans le monde. D’une certaine manière, S A V V Y est déjà un allié puisque nous sommes déjà ici, et pourrions l’être à l’avenir.
● Lambert : c’est pourquoi il est bon d’avoir Beril ici, en tant qu’allié potentiel de Brazzaville.
● Coco veut réfléchir à une structure, une organisation par département par exemple. Imaginer les services, puis évaluer la faisabilité, puis réunir des fonds, puis former les services par module, un service de communication, etc.
● Elsa : peut-être, avant de parler déjà de structure, devrions-nous documenter quelques éléments clés. Cela pourrait influencer la structure. Beaucoup de nos questions dans ce projet sont également des questions structurelles. Comment s’y prendre au XXIe siècle avec ses défis. Mais pensez aussi à la nécessité d’une telle structure. Si la nécessité est imperceptible, il se peut donc qu’il n’y ait pas besoins d’une telle structure.
● Lambert : au lieu de donner une définition toute faite, réunissons des mots-clés.
● Orakle : l’accessibilité des connaissances en matière de design.
● Lambert : nous n’avons pas besoin d’être tout en une seule personne. Il est important qu’un créateur puisse travailler avec des fabricants, dans une sorte de chaîne de production.
● Nous décidons que chacun écrive d’abord ses pensées.
● Elsa explique le but de la tâche : Mettre par écrit les objectifs principaux de cette école, en pensant aussi, si l’on veut, aux éléments / connaissances qui pourraient être échangés en dehors de Kinshasa.
● Nous lisons nos pensées et les rassemblons sur une feuille de papier commune.
Collection de mots-clés pour décrire l’école / le centre d’échange
● Concevoir pour répondre aux besoins de la population
● Centre de ressources de design
● Rendre les produits accessibles
● Un incubateur
● Un soutien continu
● Apport à la liberté des savoir-faire
● Accessibilité à tous ceux qui veulent apprendre
● La liberté d’expression
● Echange
● Réalisation d’idées de manière pratique
● Développement et enrichissement de l’esprit créatif des personnes
● Originalité
● Connaissance et solution des souhaits et des besoins de la société
● Consommation
● Déplacer la curiosité
● Soutenir la recherche
● Valorisation du design congolais
● Promouvoir le design congolais
● Accessibilité à toutes les formes de création dans le domaine du design
● Promouvoir la liberté de l’originalité avec un impact réel
● Renforcement et partage des connaissances dans les différents aspects du design
● Résidences de recherche et de création
● La concurrence entre les créateurs
● Créer des marques
● Créer des ponts entre les créations congolaises et occidentales
● Apprendre et partager les connaissances et les méthodes de travail
● Apprendre: Que chacun aie une connaissance générale et l’approfondir ensemble, partager et avoir une liberté d’expression au moment ou l’on conçoit ses projets, tout en étant accompagné(e). Aussi; accès libre à qui veut apprendre et résoudre les problèmes de différents formats
● Facilité d’échange de connaissances
● Centre d’échange de connaissances, les gens ne doivent pas être étouffés
● Un bureau d’études
● Doit permettre l’accès aux enfants, sans limite d’âge
● Centre de coordination et antennes dans les provinces et les campagnes
● Faciliter la recherche
● Revalorisation du savoir-faire congolais
● Restaurer une identité culturelle pour le peuple congolais
● Rendre accessible le partage des connaissances
● Accès à tous
● Échange autour de la créativité
● Intégration du design à tout espace / lieu / niveau de vie
● Entrepreneuriat + éducation
● Ateliers d’échange, partage des connaissances / savoir-faire locaux
● Réunir l’artisanat et le design
● Valoriser les valeurs et les connaissances perdues, faire revivre les valeurs perdues
● Repenser les raisons des pratiques
● Repenser les rôles et les titres des étudiants et des enseignants. Donner des possibilités de véritables échanges de connaissances
● Pas d’espace physique. Surtout sur le long terme. Sinon, l’attachement personnel pourrait conduire à l’exclusivité
● Créer un réseau de connaissances, non seulement sur le plan géographique mais aussi sur le plan intellectuel
● Trouver différentes formes pour ne pas tomber dans la monotonie
● Être en lien avec ce qui se passe dans le monde
● La conception et la production de réalités matérielles qui ont pour but de rendre possibles une vie commune sur cette planète entre humains mais aussi entre les humains et la nature.
● Donc repenser et renforcer ce qui nous tient ensemble en dehors des lois de l’argent et de l’exploitation
● Se poser la question; quels objets, quels systèmes communicatifs, quels espaces et leurs écosystèmes de production et de réparation faudrait-il proposer pour poser les questions pertinentes et proposer et activer cette autre réalité de vie
● Citation de Gayatri Spivak dans le concept ; nous avons besoin d’un changement épistémologique, d’un changement dans la façon dont nous « savons », d’un changement dans nos connaissances. Nous avons besoin de poètes pour réorganiser nos habitudes et nos désirs. Mais il ne s’agit pas de substituer une habitude ou un désir par un autre. Il ne suffit pas de faire seulement une façon légèrement différente d’enseigner. Cela nécessite un engagement beaucoup plus profond. Spivak dit qu’il faut réorienter les connaissances, en créant de nouveaux imaginaires.
● Un objet de design peut aussi être un objet poétique, qui pose des questions plutôt que donner des réponses. Il ne s’agit peut-être pas seulement de créer des objets fonctionnels, mais de poser les bonnes questions. Par exemple, pourquoi ne sommes-nous pas en relation avec le monde comme ceci ou comme cela ?
● Créer un vocabulaire kinois commun en dehors des écoles d’art et des institutions, qui rende possible une compréhension commune
● Repenser dans cette ligne ce qu’à Kinshasa on appelle désormais la performance ou la danse
● Partage
● Travail de groupe
● Débats de groupe
● Exclure le « moi » pour travailler collectivement, en complémentarité
● Faire connaître au monde entier ce qui se passe à Kinshasa, apporter le savoir-faire des Kinois
● Repenser l’autorité des enseignants, faire du professeur un ami (l’un apprend toujours de l’autre)
● Les forts doivent protéger les faibles, ceux qui se sentent forts doivent prendre soin des faibles
● Tolérance des enseignants pour suivre les élèves et les nouveaux développements
● Nous sommes tous des enseignants de cette école, c’est donc à nous de faire cet effort pour faire tomber la hiérarchie, les enseignants de l’école sont déjà là
Discussion plus approfondie.
Qui est l’enseignant qui est l’élève ? Qu’en est-il de la viabilité financière ? Qui ou qu’est-ce qu’un professionnel ? Comment se structurer en général et particulièrement dans cette conversation ?
● Tankwey veut lancer un débat : ne sera-t-il pas difficile d’avoir une école sans enseignants ? Nous n’avons pas le même niveau d’expérience ou de connaissances.
● Elsa : les rôles pourraient s’alterner ? Vous pouvez être enseignant un jour et étudiant le lendemain. Cette flexibilité est ce que nous entendons dire par là.
● Lambert : Il est important que les mots ne nous intimident pas.
● Elsa : Il pourrait être intéressant de réfléchir à un autre terme.
● Lambert n’est pas d’accord : Vous pouvez apprendre de n’importe qui, il n’est pas nécessaire d’avoir un titre ou un terme pour classer cela. Je prends l’exemple du village. Si tu allais y apprendre la céramique avec les mamans, tu l’appellerais tout simplement maman, c’est tout.
● Personne inconnue : Je vois plutôt cela comme des facilitateurs.
● Jonathan : l’amitié facilite l’apprentissage, aide les discussions à aller plus loin. Si vous pensez dans votre tête à quelqu’un en tant que professeur, vous passez à un autre mode. Cela fait une différence, psychologiquement.
● Eddy : S’il n’y a pas de professeur, s’il n’y a pas d’élève, qui est là ? Il ne s’agit pas de mots. Oublions les titres, mais parlons des aptitudes et des compétences que l’on peut offrir.
● Lambert : Et ce que les gens veulent enseigner.
● Homme inconnu : c’est juste un problème de terminologie. Les enseignants apprennent tout le temps de leurs élèves.
● Elsa : on parle peut-être de personnes fixes et de personnes de passage. Certains sont des participants constants, d’autres viennent prendre des connaissances et s’en vont. Mais ceux qui sont présents en permanence peuvent aussi bien être des élèves que des enseignants.
● Tankwey : Si la philosophie est bien ancrée, les titres ne posent pas de problèmes car tous les intervenants sont flexibles.
● Nada : Les Congolais ont une mentalité de commerce, comment l’éviter avec une autre philosophie?
● Coco : La plupart des personnes qui seraient intéressées par cette école ont déjà des talents artistiques, elles sont à la recherche de structures, ces personnes pourraient être considérées davantage comme des chercheurs qui recherchent quelque chose dans cette école.
● Elsa a donné le contre-exemple d’un homme qui voudrait construire un bâtiment sur son terrain et qui viendrait chercher ce savoir au centre. Il pourrait ne pas avoir ce qu’on appelle un talent artistique au début.
● Lambert : Même parmi nous, il y a maintenant des points fixes et des visiteurs. A Kinshasa, trop d’artistes attendent qu’il y ait un autre projet. Et souvent, ils produisent ensuite pour l’étranger. Mais ici, la question est très différente. Il s’agit de savoir comment l’école peut se développer ici, comment produire à Kinshasa pour la vie quotidienne. Qui sont les artistes et les espaces déjà présents qui pourraient collaborer?
● Eddy : demandez-vous comment produire localement et pour quel public. Faire des expositions / actions dans les rues ? Apprendre aux gens à acheter des œuvres d’art et de design fabriquées localement ?
● Lambert : J’ai déjà étudié le marketing. Il y a des étudiants en marketing. Ne devrait-on pas s’associer à ces personnes ? Des emplois pourraient être créés. Vous n’avez peut-être pas l’argent au début, mais vous pourriez faire des propositions commerciales « vous vendez toutes mes œuvres d’art et je vous donne 10% ».
● Beril : le monde de la culture exige une certaine transversalité, il faut des gens à tous les niveaux, s’il n’y a que des créateurs qui se réunissent, cela ne construira rien d’autre qu’un patrimoine, il faut créer une économie, lancer la machine. Le secteur qui crée des emplois est le secteur culturel, vous avez besoin d’une stratégie de développement.
● Gloire : Et quand est-ce que cela va se passer au juste avec l’école?
● Coco : Une idée serait de créer des commandes, un designer est un producteur, il produit pour vendre.
● Discussion [en lingala] pour savoir si nous devrions passer au lingala plutôt que de parler français. Nous continuons en français pour l’instant.
● Grace : Le marketing est déjà prévu dans l’école, ceci n’est pas une école mais un centre de formation
● Lambert : Il y avait une question importante à savoir quand est-ce que nous créerions des emplois avec cette école. Il donne l’exemple d’Eddy qui a créé Kin Act et Ndaku Ya La Vie Est Belle. Et donc des emplois. Les artistes créent des emplois. Aussi ceux qui ne sont pas des artistes professionnels. De nombreux artistes suivent un apprentissage pour créer. Vous pouvez employer des personnes pour faire votre travail de bureau ou d’autres choses.
● Personne inconnue : vous ne devez pas toujours penser à l’argent en tant qu’artiste. Il est vrai que l’argent est nécessaire, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas continuer à produire. Le fait de ne penser qu’à la production et à la manière de vendre nous éloigne un peu de nos questions sur le partage des connaissances, le centre d’apprentissage, etc. Sinon, nous devenons un centre de production, une entreprise. Bien sûr, nous aurons besoin de structures formelles à des fins administratives, mais l’aspect informel est également important.
● Grace : Mais s’agit-il vraiment d’un simple centre d’échange ? Il faut aussi qu’il y ait une durabilité économique.
● Elsa : quel type de financement devrions-nous essayer de trouver pour le projet ? C’est un aspect important. Chaque voie vient avec ses conditions.
● Lambert : Je vois l’idée de cette école plutôt comme une équipe nationale. Elle est composé de personnes, à différents niveaux de professionnalisme et d’expertise, qui se réunissent lorsqu’elles sont appelées. Ceux-ci jouent aussi dans d’autres équipes, mais parfois ils se réunissent pour jouer dans l’équipe nationale. Nous ne devons pas considérer cette école comme un projet en attente de financement, mais comme une production de connaissances qui a déjà lieu avec des personnes déjà impliquées.
● Coco : que faire de la connaissance ? Comment créer un autre moyen de production de design qui puisse aussi se vendre ?
● Beril : n’attendez pas le financement. Nous devons commencer, les emplois seront créés à partir de là. Avec le bagage de connaissances, vous créez du travail.
● Orakle : cette école a-t-elle pour but de gagner de l’argent ou de produire des connaissances ? Ne s’agit-il pas de donner de la force aux connaissances ?
● Gabriel Lukinga : comment partager les connaissances ?
● Elsa : comme je l’ai compris jusqu’à présent, l’idée est d’avoir un centre de recherche centralisé afin de pourvoir partager les connaissances, c’est un réseau. Pourquoi penser au financement avant d’avoir un concept ?
● Orakle illustre davantage. Si votre cours se déroule sur le marché, c’est là que se trouve l’école. Si elle se trouve au milieu de l’aéroport de Ndjili, alors c’est là qu’elle se trouve.
● Coco insiste sur la question du financement. Comment réunir les gens pour ce cours ?
● Gloire : L’école doit absolument être accessible à tous. Comment faire sans financement ? Comment faire si l’on considère qu’il s’agit d’une école professionnelle ?
● Eddy : quand vous avez un bébé, vous ne pensez pas au financement. L’argent vient toujours, nous avons besoin des idées d’abord !
● Jonathan : J’aimerais m’éloigner un peu de tout ça. J’aimerais savoir ; de qui parle-t-on quand on dit « professionnels » ? À qui pensons-nous ? Si nous convenons qu’il existe un vaste savoir sur la campagne, plus vaste qu’en ville, pensons-nous que les personnes qui font / sont ce savoir sont des « professionnels » ?
● Orakle : Pour moi, un professionnel est quelqu’un qui a une démarche artistique bien définie.
● Jonathan pense que cette compréhension devrait être élargie.
● Orakle : Il ne s’agit certainement pas d’avoir un diplôme ou d’être allé dans une école, ce n’est pas ce que je veux dire. Ça peut être n’importe qui.
● Lambert : Professionnel n’est qu’un mot. Un enfant de neuf ans peut se révéler être un « pro » car il a déjà des connaissances à nous enseigner.
● Jonathan partage ses expériences de travail à l’école Ilima et ce qu’il a appris dans la province de l’Équateur en faisant preuve d’humilité dans sa formation d’architecte.
● Elsa remet en question la neutralité de la connaissance. Quelqu’un pourrait bien avoir des connaissances, mais elles pourraient être destructrices. Nous devrions commencer à réfléchir aux connaissances que nous voudrions inclure au centre d’apprentissage. Nous pourrions aller vers plus de concret. De plus, nous essayons de trouver des structures, et même à travers cette discussion, nous sommes en train d’en établir. Cette conversation se déroule selon des lignes que nous définissons petit à petit. Dans ces situations sociales, il existe souvent des règles, avec des autorités claires. Si nous pensons à l’école, vers quelles structures nous dirigeons-nous ? Quels moyens pour apprendre, pour enseigner ?
● Lambert : Il faut peut-être commencer par supprimer les titres, ne plus appeler quelqu’un « maître » dans les conversations, arrêter d’appeler nos professeurs « maître ». Cela change déjà beaucoup dans la structure. Nous sommes en train de mettre en place une situation où chacun a sa place et est respecté. Il faut savoir écouter TOUT LE MONDE. Qu’il soit enfant, étudiant, vieux ou étranger. Démocratiser le savoir.
● Coco : Suivons la proposition et passons à la réflexion sur ce qu’est l’enseignement et l’apprentissage que nous pourrions imaginer dans l’école ?
● Nous décidons de faire une autre liste avec les sujets qui pourraient être enseignés / appris à l’école.
Collection de sujets qui pourraient être enseignés et appris
● Protection de l’environnement
● Amélioration des conditions d’insalubrité
● Utilisation de matériaux et d’équipements locaux et leur manipulation
● Outils possibles
● Savoir-faire local, pratiques kinoises du passé, du présent et du futur
● Matérialité / Matériaux
● La liberté de création
● Techniques de peinture
● Compétitivité sur le marché international
● Économie
● Logement
● Architecture
● Recyclage
● Psychologie – comportement social
● La théorie des couleurs
● Histoire des peuples
● Fusion d’idées – travail d’équipe
● Philosophie
● Décolonisation mentale
● L’autocritique, la critique de son propre travail
● Mondialisation
● Connaissances musicales et performatives
● Rédaction
● Observation
● Modèles
● Recherche
● Design de mode
● Textiles
● Vidéo
● Construction de l’identité, image
L'amour vit au seuil des portes (un hommage à Audre Lorde)
Une recette par Luiza Prado
Carottes arc-en-ciel avec des fanes de carottes confites, des oignons grelot ca-ramélisés, de la gelée à la cardamome et à l’orange, du charbon actif, des micro-pousses de roquette.
Pour 15 personnes en entrée
Carottes et fanes 1 kg de carottes arc-en-ciel, avec les fanes 1 tasse d'eau 1 tasse de vinaigre 2 cuillères à soupe de sucre 1 cuillère à soupe de sel
Oignons caramélisés 200 g d'oignons grelot, pelés et coupés en deux ½ cuillère à soupe d'huile d'olive 2 cuillères à café de sucre Sel au goût
Gelée à la cardamome et à l'orange 300 ml de jus d'orange 1 ½ cuillère à café de poudre d'agar 5 gousses de cardamome verte, grillées puis moulues Sel au goût
Pour servir 1 paquet de micropousses de roquette 1 paquet de charbon actif
1. Séparez les fanes des carottes et mettez-les de côté. Coupez les carottes arc-en-ciel en fines tranches avec une mandoline en biais. Elles doivent avoir une épais-seur d'environ 3 mm. Salez-les et mettez-les de côté.
2. Séparez les fanes des tiges des carottes. Pour les mariner, faites bouillir l'eau, le vinaigre, le sucre et le sel. Versez le mélange chaud sur les fanes et réservez, lais-sez refroidir.
3. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle anti-adhésive à feu moyen-doux. Saupoudrer le sucre sur toute la surface de la poêle. Mettez les oignons, les moitiés coupées vers le bas, sur la poêle. Laissez-les caraméliser légèrement, environ 7 mi-nutes.
4. Mélangez le jus d'orange avec l'agar et la cardamome dans une casserole. En remuant, porter à ébullition. Laissez bouillir pendant environ 2 à 3 minutes, puis trans-férez le mélange dans une casserole rectangulaire, assez grande pour avoir une couche de jus d'environ 2 cm de profondeur. Mettez au réfrigérateur pour que la gelée prenne, au moins 3 heures. Une fois prise, coupez en cubes de 2 cm.
5. Lorsque tout est pris et refroidi, pour servir : prendre une tranche de carotte. Garnissez-la d'une petite quantité de fanes marinés, de quelques pétales d'oignon grelot de chaque côté et d'un cube de gelée orange-cardamome au milieu. Recouvrez avec du charbon actif émietté et les micropousses de roquette.
The earview at the border (La vue de l’oreil à la frontière)
Une mixtape de recherche ou une recherche de mixtape Pedro OliveiraMon travail de chercheur en design s’articule dans une pensée située. C’est-à-dire que je comprends que ma recherche – ou toute autre recherche d’ailleurs – parle à partir de ma propre position sociale, ma propre politique corporelle et la relation entre celles-ci et le monde qui m’entoure. Par conséquent, toute tentative d’entreprendre une recherche exprimera inévitablement ma propre vérité personnelle, et la façon dont je choisis de relier ma vérité à celle des autres et elle doit être un atout fondamental de toute entreprise de travail. En ce sens, je conteste directement le fait que le design soit un « langage universel » et que, bien que le design soit une activité humaine inhérente, cela se fait à partir de différents lieux d’énonciation (pour reprendre une idée de Walter Mignolo). En même temps, mon lieu d’énonciation n’est pas une fin en soi, mais est en dialogue constant avec d’autres lieux, d’autres réalités et d’autres imaginaires. Toute réflexion que j’entends mener en tant que chercheur est, par essence, une forme de pensée frontalière (pour reprendre le processus de Gloria Anzaldúa).
La mixtape suivante tente d’utiliser l’écoute, le son et la musique comme une articulation de la pensée frontalière ; dans ma thèse, j’ai appelé cette articulation « la vue de l’oreille ». Tout au long de mes recherches doctorales sur les relations entre design, racisme et violence policière au Brésil, j’ai eu le sentiment que la production musicale et sonore réalisée autour et contre la violence policière parlait plus fort et racontait des histoires plus complètes que celles que je racontais dans le cadre de mes recherches universitaires et de design. Cette mixtape présente donc une collection (située, conservée, incomplète) de chansons qui m’ont inspiré ou que ma recherche a cottoyé. L’auditeur y trouvera des enregistrements personnels sur le terrain, des chansons funk inédites, des medleys et des mixes, ainsi que ma propre playliste pour écrire. C’est une tentative d’étendre la matérialité du langage conceptuel au sonique, et de faire de la recherche et produire de la connaissance à travers le mixage, l’enregistrement, l’écoute, en prenant du temps, et en étendant la possibilité de ce que pourrait être la « recherche ».
Asseyez-vous ou dansez dessus, pensez avec et à travers votre corps, et surtout : profitez de la balade.
Fulu Miziki
Elie Mbansing
Au cours du chapitre de Kinshasa de Triangles Tournoyants, un groupe de recherche sur le design s’est réuni, maintenant appelé « Banka ». Un de leurs membres, Elie Mbansing, a réalisé plusieurs courts métrages dont trois sont présentés ici. Elie Mbansing s’est particulièrement intéressé à la présentation de créatifs, qui visent à reformuler le quotidien.
Fulu Miziki est un collectif d’artistes et un groupe, célèbre pour ses instruments assemblés à partir d’objets jetés. Les membres du groupe (Pisko Crane, Aicha Mena Kanieb, Le Meilleur, DeBoul, La Roche, Padou, Sekelembele et Tche Tche) adaptent leurs styles musicaux et visuels rigoureusement pour faire passer des messages à Kinshasa et au-delà.
Des sous-titres pour ce film sont disponibles en anglais et en allemand.
Kikuku Cuisine
Elie Mbansing
Au cours du chapitre de Kinshasa de Triangles Tournoyants, un groupe de recherche sur le design s’est réuni, maintenant appelé « Banka ». Un de leurs membres, Elie Mbansing, a réalisé plusieurs courts métrages dont trois sont présentés ici. Elie Mbansing s’est particulièrement intéressé à la présentation de créatifs, qui visent à reformuler le quotidien.
Au cours du chapitre de Kinshasa de Triangles Tournoyants, un groupe de recherche sur le design s’est réuni, maintenant appelé « Banka ». Un de leurs membres, Elie Mbansing, a réalisé plusieurs courts métrages dont trois sont présentés ici. Elie Mbansing s’est particulièrement intéressé à la présentation de créatifs, qui visent à reformuler le quotidien.
En réponse au travail d’autres membres de la Banka, « Kikuku Cuisine » s’est développé à travers l’exploration de deux objets d’usage quotidien à Kinshasa qui ont traversé les époques et survécu à la colonisation. Elie Mbansing a suivi les objets (le mortier et le pilon « liboka », ainsi que le mélangeur de fufu « nzete ya fufu ») de la production à l’utilisation et a interviewé Adeline Boyube, bien connue pour sa cuisine dans les milieux artistiques et autres.
Des sous-titres pour ce film sont disponibles en francais, allemand et anglais.
Lisanga Bankoko
Elie Mbansing
Au cours du chapitre de Kinshasa de Triangles Tournoyants, un groupe de recherche sur le design s’est réuni, maintenant appelé « Banka ». Un de leurs membres, Elie Mbansing, a réalisé plusieurs courts métrages dont trois sont présentés ici. Elie Mbansing s’est particulièrement intéressé à la présentation de créatifs, qui visent à reformuler le quotidien.
« Lisanga Bankoko » est un court métrage sur une association du même nom. Fondée par Lema Diandandila, Lisanga Bankoko a pour but de réunir le savoir-faire des anciens avec les pratiques de la vie contemporaine, par exemple le mouvement des SAPPEURS de Kinshasa. Ainsi, les membres posent des questions sur l'héritage culturel et sur la manière de trouver des ponts de communication entre le présent et les ancêtres.
Des sous-titres pour ce film sont disponibles en francais, en allemand et en anglais.
Cheick Diallo
La Rue Comme Laboratoire du Possible
Cheick Diallo (*1960, Mali) a fait une carrière internationale qui force le respect et l’admiration. En 2014, il a décidé de rentrer au bercail (le Mali) pour mettre son art et son talent au service de ses compatriotes. Né dans les années 1960, il part en France pour effectuer des études d’architecture en 1991 et fini par être diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI), l’une des plus prestigieuses écoles de design de France. Bien qu’étant loin de son Mali natal, Cheick Diallo a toujours œuvré pour son pays en formant des artisans et en les associant à la réalisation de bon nombre de ses œuvres. En véritable chantre du savoir-faire artisanal, il fait opérer sa magie en concevant les objets du quotidien à travers une vision contemporaine et résolument novatrice. Son implication dans la valorisation du design « Made in Africa » s’est matérialisée par la mise en place de l’Association des designers africains (ADA), dont il est le président depuis 2004. Son travail a été récompensé à plusieurs reprises par de multiples distinctions toutes aussi prestigieuses les unes que les autres. Ses œuvres se retrouvent désormais dans les collections permanentes de grands musées en France, en Angleterre, en Suisse, en Belgique et aux États-Unis. Influencé par les écoles anglo-saxonne et française, Cheick Diallo prône le métissage culturel comme ligne directrice de ses créations.
Dans sa présentation La Rue Comme Laboratoire du Possible, Cheick Diallo interroge le design dans ses bases: Quand on pense le design, il faut aussi penser aux activités quotidiennes, partagées et répétées dans la vie humaine — dormir, s’asseoir, manger, etc. À partir de cela, on peut se poser des questions sur la relation entre les corps, les activités et les objets, formés pour soutenir, guider et peut-être contredire la vie des kinois. Quelles histoires dites et inédites se cachent dans ces objets ? Que sont — et qui sont — les produits ? Pourquoi sont-ils formés ainsi ? Quel écosystème de production mais aussi d’usage, de recyclage et de réparation les entoure ? Serait-il possible de les repenser et de les refaire ?
Koyo Kouoh
RAW Académie: Une Question de Nécessité
Koyo Kouoh (*1967, Cameroun) est la fondatrice et directrice artistique de RAW Material Company. Elle a participé à la 57ème édition de Carnegie International, 2018, avec Dig Where You Stand, une exposition au sein de l’exposition de la collection du Carnegie Museum of Art. Avec Rasha Salti, elle a récemment co-commissarié Saving Bruce Lee : le cinéma africain et arabe à l’ère de la diplomatie culturelle soviétique à la Haus der Kulturen der Welt (Maison des Cultures du Monde) à Berlin. Auparavant, elle était commissaire de 1:54 FORUM, le programme éducatif de la Foire d’art contemporain africain à Londres et à New York, et fut membre des équipes de commissariat des documenta 12 (2007) et 13 (2012). Kouoh était la commissaire de Still (the) Barbarians, 37ème édition d’EVA International, la Biennale d’Irlande à Limerick (2016) ; et a organisé de nombreuses expositions à l’échelle internationale et publié largement, y compris Word ! Word ? Word ! Issa Samb et la forme indéchiffrable, RAW Material Company/OCA/Sternberg Press (2013), la première monographie consacrée à l’œuvre de l’artiste sénégalais Issa Samb; État des lieux sur la création d’institutions d’art en Afrique, une collection d’essais résultant du symposium éponyme qui s’est tenu à Dakar en janvier 2012; et Chronique d’une révolte: Photographies d’une saison de protestation, RAW Material Company et Haus der Kulturen der Welt (2012). En plus d’un programme soutenu de théorie, d’expositions et de résidences à RAW Material Company, elle maintient une activité critique de commissariat et de conseil et est régulièrement membre de jury et de comités de sélection à l’échelle internationale. En mars 2019, Koyo Kouoh a été nommée Directrice éxecutive et Commissaire en chef du Musée d’art contemporain africain (Zeitz Mocaa), au Cap en Afrique du Sud. Elle vit et travaille à Dakar, Cape Town et Bâle et est consciemment accro aux chaussures, aux tissus et à la nourriture.
RAW Académie: Une Question de Nécessité: La formation artistique en Afrique fait partie d’un système soigneusement élaboré de transmission des compétences et de construction du pouvoir visuel depuis que nous avons commencé à produire des objets, des formes, des esthétiques et des imaginaires. L’absence d’écoles d’art dans la tradition universitaire occidentale jusqu’il y a cent ans environ, ne signifie pas qu’il n’existait aucun concept d’esthétique, ni de production et de transmission du savoir, mais que ces objets ont des cosmologies et des épistémologies créatives très différentes. La grande majorité de la formation artistique actuelle ne tient pas compte de ces vérités, notamment sur le continent africain. De plus, en cette époque de privatisation généralisée du secteur de l’enseignement supérieur dans le monde et de stagnation économique générale, les étudiants des arts et des sciences humaines sont laissés à la merci du marché financier et de ses forces d’homogénéisation culturelle.
Saki Mafundikwa
Kinshasa: Libérer Le « Design » De Ses Chaînes Occidentales
Saki Mafundikwa (*1955, Harare, Zimbabwe) est le fondateur et directeur de Zimbabwe Institute of Vigital Arts (ZIVA, l’Institut de Arts Vigital du Zimbabwe), une école de formation en design et nouveaux médias à Harare. Il a une maîtrise en Design Graphique de l’université de Yale. Il est rentré chez lui en 1998 pour fonder ZIVA après avoir travaillé à New York en tant que graphiste, directeur artistique et professeur de design. Son livre Afrikan Alphabets : The Story of Writing in Africa, a été publié en 2004. En plus d’être d’importance historique, il s’agit également du premier livre sur la typographie africaine. Le livre est actuellement épuisé, mais une deuxième édition est en préparation. Son premier film primé, Shungu: The Resilience of a People a été présenté pour la première fois au Festival International d’Amsterdam du film documentaire (IDFA) en 2009. Actif dans le circuit international de la littérature, il a été conférencier à la TED2013 à Long Beach, Californie. Il a également animé des ateliers pour des étudiants en design en Europe, aux États-Unis, en Amérique centrale et en Afrique. Il a publié de nombreux ouvrages sur le design et la culture. Il travaille actuellement sur une édition revisitée de Afrikan Alphabets dont il espère qu’elle sera publiée début 2020. Enseignant au Cornish College of the Arts de Seattle, Saki passe deux années sabbatiques à donner des conférences et animer des ateliers dans des collèges américains et canadiens. Pour aider ZIVA à naviguer dans le difficile contexte économique du Zimbabwe, il vient de rentrer à Harare. Il a récemment prononcé le discours d’ouverture de la première conférence de l’Institut Panafricain du Design au Ghana.
Pour le symposium de Triangles Tournoyants à Kinshasa, Saki Mafundikwa s’est embarqué sur le chemin suivant : « La création d’un ‹ modèle › de design qui découle de l’idée d’un Bauhaus de son propre temps et de son espace, résultant de son lieu de naissance et de ses origines à Kinshasa, ouvre la discussion sur ce que le design est, ou devrait être, et souligne le besoin de repenser ce concept sur le continent africain. Afrika ne peut pas continuer sous la dictature du concept design. Afrika a toujours eu un ‹ Design ›, mais l’Occident a toujours dicté la signification de ce concept. Le temps est maintenant venu de décoloniser ce terme. C’est opportun, car nous sommes témoins des minorités et de l’opposition occidentale qui réclament la décolonisation des canons, en particulier sur les campus universitaires aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Europe. Les hordes marginalisées sont agitées et se battent pour l’inclusion. Les approches pédagogiques doivent changer, car le statu quo est fatigué et ne fonctionne tout simplement pas. L’art afrikain a influencé les artistes européens qui ont conduit au modernisme, tout comme l’art asiatique et d’autres formes d’art ‹ non occidentales › — l’appel à la décolonisation du design est tout aussi large. Les étudiants de sociétés non-occidentales sont ‹ forcés › de se laisser prendre dans le carcan occidental de ce que ‹ Design › est… Je ne souligne que la perspective Afrikaine parce que je suis Afrikain. Par le biais d’images fixes et de vidéos, je montrerai qu’Afrika a toujours eu une esthétique. En fait, le sens esthétique des Afrikains a toujours été rehaussé. Après tout, l’humanité elle-même, est née sur le continent. Afrika et ses enfants l’ont donc inventée. »
Summer School
Berlin
Pour le projet Triangles Tournoyants, S A V V Y Contemporary s’est transformé pendant un mois en une « école » de design, que l’on pourrait aussi bien appeler une « non-école », en suivant les méandres entre modernité et colonialité, en s’interrogeant sur leurs répercussions sur le « faire-monde », ses schémas directeurs évidents et moins évidents. En explorant les méthodes et les pratiques en parallèle à ces discussions, quarante participant·e·s, cinq invité·e·s de Kinshasa, ainsi que les initiateurs d’ateliers ont progressivement donné forme à cet environnement d’apprentissage. Ensemble, des formes de co-vivre et de co-création ont été négociées, évoquant le racisme systémique, les privilèges blancs ancrés, les questions de confort et d’inconfort, d’oppression et de complicité, de résilience et de résistance.
Pan Lu
Oublier l’Inoubliable: Monuments et Espaces Changeants de la Mémoire de Guerre
Pan Lu est professeur adjointe au Département de la culture chinoise de l’Université polytechnique de Hong Kong. Elle a été chercheuse invitée et boursière à l’Université technique de Berlin (2008 et 2009) et au Harvard-Yenching Institute (2011–12), chercheuse en résidence au Fukuoka Asian Art Museum (2016) et chercheuse invitée à l’Université nationale des arts de Taipei (2018). Pan est l’auteur de deux monographes : In-Visible Palimpsest: Memory, Space and Modernity in Berlin and Shanghai (Peter Lang, 2016) et Aestheticizing Public Space : Street Visual Politics in East Asian Cities (Intellect, 2015). Elle a traduit en chinois Über das Neue de Boris Groys (Chongqing University Press, 2018). Son film Miasma, Plants and Export Paintings (co-réalisé avec Bo Wang, 2017) a reçu le Prix d’excellence, au 32e Festival Image Forum, Tokyo, Japon.
Oublier l’Inoubliable : Monuments et Espaces Changeants de la Mémoire de Guerre : Depuis la Seconde Guerre mondiale, les espaces publics dans lesquels les monuments de guerre ontété érigés — parfois par les autorités coloniales — ont été rattrapés par le développement urbain rapide et les changements politiques majeurs qui ont eu lieu en Chine continentale, à Hong Kong et à Taiwan. Par conséquent, le cadre spatial, les représentations visuelles et la signification de ces monuments ont changé radicalement. Ce projet explore les processus par lesquels ces nouveaux contextes spatiaux, mémoires publiques et significations se sont développés.
Ema Tavola
Lain Blo Yu Mi — Notre Peuple Nos Lignes
Ema Tavola est une artiste-commissaire indépendante basé à South Auckland, en Nouvelle-Zélande. Elle est une artiste visuelle et gérante de la Fresh Gallery Ōtara, une galerie d’art communautaire d’Auckland financée par le gouvernement local. Les préoccupations de Tavola en matière de commissariat sont fondées sur les possibilités qu’offre l’art contemporain d’engager les publics divers, de modifier les politiques de représentation et d’archiver les expériences de la diaspora du Pacifique. Tavola considère le commissariat comme un mécanisme d’inclusion sociale, et la réalisation d’expositions comme un mode de décolonisation, qui ensemble centralisent le(s) point(s) de vue indigène(s) dans la région du Pacifique. En 2019, Tavola a créé Vunilagi Vou, une galerie indépendante et une agence créative dans le sud d’Auckland. Ses récents projets de commissariat comprennent A Maternal Lens, la 4e Biennale internationale de Casablanca (2018), Kaitani, The Physics Room, Nouvelle-Zélande (2017), et Dravuni : Sivia yani na Vunilagi — Beyond the Horizon, pour le Musée maritime de Nouvelle-Zélande (2016) et l’Oceania Centre for Arts, Université du Pacifique Sud (2018).
La présentation Lain Blo Yu Mi — Notre Peuple Nos Lignes examine le terrain personnel et politique de la renaissance du tatouage féminin mélanésien par rapport à la pratique de la praticienne de Papouasie-Nouvelle-Guinée-Australie, Julia Mage’au Gray. S’inspirant des traditions Mekeo de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la pratique de Mage’au est un processus de collaboration, socialement enraciné, de création de marques corporelles. Là où les traditions de tatouage étaient menacées et dans certains cas effacées par le processus de colonisation, la ré-appropriation du corps et la reconnexion avec les vocabulaires visuels ancestraux a eu un impact transformateur sur la communauté des femmes mélanésiennes que Mage’au a marquée. Dans deux projets d’exposition interconnectés centralisant la pratique de Mage’au, à Auckland, Nouvelle-Zélande (Vunilagi Vou, 2019) et à Londres, Angleterre (Interni Design Studio, 2020), les questions de protection, d’amplification, de propriété et de partage sont examinées dans le contexte même de l’exposition, la galerie et son écologie créative étant inextricablement liées aux systèmes colonialistes.
Katerina Teaiwa
Project Banaba
Katerina Teaiwa est professeur associée à l’École de Culture, d’Histoire et de Langue du Collège d’Asie et du Pacifique de l’Université nationale australienne. Elle est également une artiste visuelle qui intègre la recherche universitaire dans sa pratique. Son exposition solo Project Banaba (2017), organisée par Yuki Kihara et commissionnée par Carriageworks, Sydney, a récemment été présentée dans des espaces d’exposition internationaux. Katerina a également une expérience de la danse contemporaine du Pacifique et est co-fondatrice de l’Oceania Dance Theatre à l’Université du Pacifique Sud, Fidji. Elle est d’origine Banaban, I-Kiribati et afro-américaine, et est l’auteur de Consuming Ocean Island : histoires des peuples et du phosphate de Banaba (2014).
Pour le chapitre de Hong Kong de Triangles Tournoyants, Katerina Teaiwa a discuté de la création du Projet Banaba, une installation multimédia composée de trois sections : Body of the Land, Body of the People ; The mines : for Teresia ; et Teaiwa’s Kainga, représentant trois phases de pratique créative et de recherche concernant son île ancestrale, Banaba. Le projet convertit des œuvres archivistiques, ethnographiques et vidéo en une histoire à plusieurs niveaux. Pendant des milliers d’années, les Banabans ont vécu dans des conditions difficiles et relativement isolées. Pendant plus de 80 ans au XXème siècle, l’île a été exploitée pour en tirer du phosphate, répandu comme engrais sur les fermes coloniales de la Grande-Bretagne, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les Banabans ont depuis été déplacés vers Fidji ou ailleurs, ils sont polyvalents et créatifs, et survivent dans des espaces difficiles sur le plan politique et environnemental. Le projet Banaba vise à retracer l’itinéraire de cette île éloignée, en récupérant te aba : le « corps de la terre » et les « corps des gens ».
Sugata Ray
Avec Le « Glouglou » d’une Dinde: Visualisation des Relations Entre l’Homme et l’Animal Dans la Région de l’Océan Indien
Sugata Ray est professeur associé au département d’histoire de l’art et au département d’études sur l’Asie du Sud et du Sud-Est de l’Université de Californie, Berkeley. Ses recherches portent sur les intersections entre les cultures artistiques des débuts de la modernité et de la colonisation, les écologies transterritoriales et l’environnement naturel. Il est l’auteur de Climate Change and the Art of Devotion: Geoaesthetics in the Land of Krishna, 1550–1850 (2019), Water Histories of South Asia: The Materiality of Liquescence (coédité, 2019), et Ecologies, Aesthetics, and Histories of Art (coédité, paraîtra prochainement). Son projet de livre en cours est provisoirement intitulé Matter, Material, Materiality : Histoires de l’art de l’océan Indien au début des temps modernes.
Avec Le « Glouglou » d’une Dinde: Visualisation des Relations Entre l’Homme et l’Animal Dans la Région de l’Océan Indien: Alors que nous faisons face à la sixième extinction, l’extinction la plus massive et dévastatrice des espèces animales au cours des soixante-six derniers millions d’années, il se pose la question si une attention renouvelée aux relations homme-animal peut modifier les tendances spéciste de l’histoire de l’art, qui trouve ses racines dans la rationalité des Lumières. En prenant des peintures du XVIIème siècle de la dinde d’Amérique du Nord — un oiseau qui a été introduit dans le monde de l’océan Indien durant la période d’impérialisme écologique européen dans les Amériques — comme point de départ, je raconte une histoire de l’art qui perçoit les représentations visuelles du monde naturel, non seulement comme une technique pour coloniser et spéculer sur la forme de vie non humaine, mais comme le résultat des relations inter-espèces qui ont façonné les pratiques artistiques au début de la période moderne. Mon but est d’obscurcir les frontières des espèces telles qu’elles étaient etablies dans le siècle des Lumières pour faire place à une histoire de l’art poreuse dans laquelle l’autre — animal ou autre — habite dans la différence. Une telle histoire, je propose, pourrait offrir de nouvelles façons de lire la création artistique qui se confronte au rationalisme logocentrique de l’histoire de l’art métropolitain européen, en particulier dans notre présent Anthropocène lorsque l’orgueil humain conduit à l’extinction massive d’innombrables espèces animales dans le biomonde de l’Océan Indien.
 Wohnmaschine, B-AU 7105 / O Jalloh (Machine-à-Vivre, B-AU 7105 / O Jalloh), installation de Van Bo Le-Mentzel, dediée à Oury Jalloh
Wohnmaschine, B-AU 7105 / O Jalloh (Machine-à-Vivre, B-AU 7105 / O Jalloh), installation de Van Bo Le-Mentzel, dediée à Oury Jalloh
Dans le cadre du projet Triangles Tournoyants, Van Bo Le-Mentzel a créé une nouvelle Tiny House, la « Wohnmaschine » (machine-à-vivre). Il s’agit d’un clone miniature de la célèbre aile d’atelier du bâtiment de l’école du Bauhaus de Dessau. Elle cache, derrière sa façade iconique, un studio de quinze mètres carrés en parfait état de fonctionnement. Cet espace habitable, en plus d’être muni d’une décoration intérieure adaptée, est également une salle d’exposition. Une maison qui s’est transformée tout au long de ce premier chapitre du projet à Dessau, en accueillant une salle de lecture, des ateliers, des déjeuners et des conversations, et en permettant à ses utilisateurs et visiteurs de s’engager de manière ludique et active dans ses possibilités et impossibilités. S A V V Y Contemporary a habité cet espace pendant deux semaines à Dessau et ouvert son salon au public et aux étudiant·e·s de Dessau afin de créer une « académie du coin de feu » [1].
[1] https://S A V V Y-contemporary.com/en/about/concept/
 Hechizos et Offrandes Modestes du Grand Marché. Eliana Otta and Nada Tshibwabwa
Hechizos et Offrandes Modestes du Grand Marché. Eliana Otta and Nada Tshibwabwa
Le mot « hechizo », qui signifie littéralement « envoûtement » en espagnol, est utilisé dans l’argot péruvien pour désigner « quelque chose de transformé » (hecho = fait). Il s’agit d’un objet, adapté à partir de choses existantes que l’on trouve à portée de main. Cette double stratification de sens pose la question de savoir : si l’habitude de créer des « hechizos », nés du besoin, peut être comprise comme un savoir précieux, capable de relier une possible intersection entre l’artisanat, le design et les spiritualités (renouvelées). L’artiste Eliana Otta, après avoir présenté ses réflexions sur ce sujet lors du symposium de Triangles Tournoyants à Kinshasa, s’est associée à l’artiste Nada Tshibwabwa et à l’espace Timbela Batimbela Yo. Travaillant avec des enfants et des adolescent·e·s qui vivent dans et grâce au Grand Marché de Kinshasa, ils ont discuté des objets qui les entourent dans la vie quotidienne, afin de les repenser et de les réinventer, de leur donner une seconde vie et de nouveau pouvoir, de leur inventer des enchantements, des sorts de protection et de créer des masques.
 Schweigen tötet (Le silence tue), posters pour la 14ème commémoration annuelle de l’assassinat de Oury Jalloh. Photo: S A V V Y Contemporary
Schweigen tötet (Le silence tue), posters pour la 14ème commémoration annuelle de l’assassinat de Oury Jalloh. Photo: S A V V Y Contemporary
Depuis 2005, chaque 7 janvier, les manifestations commémoratives demandant justice pour le meurtre non résolu d’Oury Jalloh dans une cellule de la police de Dessau, ont lieu. Afin de soutenir la protestation, le projet Triangles Tournoyants a organisé un atelier, où les participant·e·s se sont questionné·e·s intensivement sur les raisons de ce crime et ont travaillé collectivement à la conception de bannières de protestation. L’atelier était guidé par Mouctar Bah, ami de Oury Jalloh, militant et fondateur de Initiative in Gedenken an Oury Jalloh e.V. (Initiative en mémoire d’Oury Jalloh), et Alexander Lech, designer de communication et membre de VorOrt-Haus Dessau. Les affiches ont été distribuées et largement utilisées pendant la manifestation.
 Impossible Methods (Méthodes Impossibles), atelier avec Decolonising Design. Pedro Oliveira, Luiza Prado
Impossible Methods (Méthodes Impossibles), atelier avec Decolonising Design. Pedro Oliveira, Luiza Prado
Deux membres de Decolonising Design, Pedro Oliveira et Luiza Prado, ont dirigé deux ateliers, à Dessau et à Berlin. Au cours de ces ateliers, les participant·e·s « partent d’un artefact, qu’on leur demande d’apporter à l’atelier — en répondant à un ensemble de mots clés ou à un énoncé donné — et de déballer lentement les réseaux qui informent l’existence de cet objet dans le monde, ainsi que ses implications lorsque utilisé », reflétant ainsi les processus de conception : « l’acte de concevoir produit d’autres conceptions dans ce monde. Cet atelier a pour but de créer un réseau de relations entre les individus et le monde, en intervenant dans un enchevêtrement de processus, de performances, d’interactions, de récits et de relations dépendant d’un contexte et influencés par des facteurs socioculturels. En d’autres termes, nous comprenons l’acte de conception comme un acte de production d’un discours matériel » (Pedro Oliveira, Luiza Prado).
 Contre-Héritage Comique : Bandes Dessinées, Colonialisme, Représentation, et Modernité. Workshop Lambert Mousseka
Contre-Héritage Comique : Bandes Dessinées, Colonialisme, Représentation, et Modernité. Workshop Lambert Mousseka
L’atelier Contre-Héritage Comique : Bandes Dessinées, Colonialisme, Représentation, et Modernité était une conversation continue avec des étudiant·e·s, des passant·e·s et des visiteur·euse·s de Dessau, à qui il a été demandé de raconter, à travers des dessins, des histoires liées à leur expérience à Dessau et aux sujets en jeu dans Triangles Tournoyants. Selon les mots de l’initiateur de l’atelier, Lambert Mousseka : « Le colonialisme est principalement défini comme la somme des principes qui ont régi les relations de pouvoir passées entre l’Europe et le monde colonisé. Mais nous devons faire face à la réalité : la colonisation fait toujours activement partie de notre présent à de nombreux niveaux et fait donc partie des ‹ normalités › quotidiennes. Elle est présente dans ce que nous lisons, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, nos façons de nous déplacer. Dans cet atelier, nous nous concentrerons activement sur la décolonisation de la pensée-action et les formes qu’elle peut produire. Mais cela n’est pas possible sans parler de racisme et d’autres humiliations qui s’expriment dans les manières de nos rencontres ».
 Spinning Triangles symposium à l’Académie des Beaux-Arts, Kinshasa
Spinning Triangles symposium à l’Académie des Beaux-Arts, Kinshasa
Lors du symposium de Triangles Tournoyants à Kinshasa, le public a échangé avec Sinzo Aanza, Banka (Jonathan Bongi, Jean Kamba, Elie Mbansing, Malaya Rita, Jean-Jacques Tankwey), Cosmin Costinas, Cheick Diallo, Eddy Ekete, Iviart Izamba, Henri Kalama, Koyo Kouoh, Lisanga Bankoko (Lema Diandandila, Mavita Kilola, Mbo Mbula, Lutadila Lukombo), Saki Mafundikwa, Orakle Ngoy, Cedrick Nzolo, Colette Poupie Onoya, Eliana Otta, Tabita Rézaire, Simon Soon, Tau Tavengwa, Ema Tavola, Ola Uduku and Dana Whabira.
Le symposium s’est orienté sur les principaux thèmes de Triangles Tournoyants — théorie, pratique et pédagogie du design — tout en essayant de recadrer son histoire, en ouvrant de nouvelles voies et en discutant des possibilités de pratiques en dehors des structures hégémoniques. Chaque jour était centré sur un thème directeur :
Commencer au milieu des choses : un début avec trois perspectives sur notre condition contemporaine, des discours performatifs et un rassemblement festif dans le quartier de Matonge.
Habitudes, Désirs et Nécessités : un jour à multiples facettes qui nous amène aux relations profondes des objets et des histoires qu’ils dégagent.
Polyphonie éducative et espaces des savoir(-faire) : un jour où plusieurs visions et expériences dans le domaine de l’éducation se confrontent pour échanger perspectives, questions, expériences.
Corps mêlés, collisions spatiales : un jour où les contributeurs nous amènent dans le monde des conceptions spatiales. Que ce soient les idées architecturales, leurs influences sur nos vies quotidiennes et les corps qui les habitent ou des provocations urbaines.
 La Rue Comme Laboratoire du Possible atelier. Cheick Diallo
La Rue Comme Laboratoire du Possible atelier. Cheick Diallo
Partant d’activités quotidiennes, partagées et répétées dans la vie humaine — comme dormir, s’asseoir, manger — l’atelier posera des questions sur la relation entre les corps, les activités et les objets, formés pour soutenir, guider et peut-être contredire la vie des kinois·es. Après avoir choisi une de ces activités, nous entamons son analyse approfondie et du rôle sociale qu’elle joue dans la vie urbaine de Kinshasa. Quelles histoires dites et inédites se cachent dans ces objets ? Qui les produits et pourquoi ? Pourquoi sont-ils formés ainsi ? Quel écosystème de production mais aussi d’usage, de recyclage et de réparation les entoure ? Y a-t-il un moyen de les repenser et de les refaire ?
Cet atelier a été initié et guidé par Cheick Diallo, designer et designer-penseur malien, qui tout au long de sa carrière n’a cessé de remettre en question les observations et les pratiques pour proposer des objets qui ne sont pas seulement utiles et beaux, mais qui sont également remplis de questions importantes sur notre façon d’être dans le monde.
L’atelier était accompagné par Jean-Jacques Tankwey.
 Esprits et Corps-Matières atelier. Lambert Mousseka
Esprits et Corps-Matières atelier. Lambert Mousseka
À travers une observation attentive et un engagement expérimental avec les matériaux impliqués dans la vie quotidienne de Kinshasa, les participant·e·s se demanderont quels sont les esprits qui habitent ces matériaux et de quelles histoires ils parlent. Au cours de plusieurs activités, les participant·e·s poseront des questions de ce qu’est l’animé et l’inanimé — et associeront les matériaux et leurs histoires à leurs propres corps. Après avoir expérimenté avec de l’argile et d’autres matériaux, les participant·e·s ont décidé de fabriquer des objets pouvant protéger les corps, en soulignant par exemple la nécessité de faire face aux accidents routiers.
L’initiateur de l’atelier, Lambert Mousseka, a activé un réseau intergénérationnel d’artisans et d’artistes aux alentours de l’Espace Masolo, un espace qu’il a co-fondé à Kinshasa en 2003.
L’atelier était accompagné par Elie Mbansing.
 Concevoir pour L’impact. Jean Paul Sebuhayi Uwase
Concevoir pour L’impact. Jean Paul Sebuhayi Uwase
Dans cet atelier, nos questions ont tourné autour des conceptions d’espace d’enseignement au sens large : où et comment est partagé le savoir à Kinshasa et que sont les éléments spatiaux, matériels et immatériels de cette transmission? Afin de se rapprocher de la compréhension de ces questions pour construire un pont vers leur mise en application, Jean Paul Sebuhayi Uwase a proposé d’examiner de près les principes de « Design Thinking » (littéralement « Pensée Design »). Par rapport aux méthodologies qui privilégient les solutions préconçues, le « Design Thinking » permet une compréhension fondée des problématiques intrinsèques d’un projet précis, centrée sur l’utilisateur ou le groupe concerné, plutôt que sur le concepteur. Se posaient alors les questions : Comment concevoir au-delà de la fantaisie individuelle, tout en proposant des solutions percutantes ? Et pour ce projet : Le « Design Thinking » peut-il nous emmener vers des idées praticables qui pourront donner forme à une potentielle école ou non-école du design, capable de proposer des « re-form-ulations » de notre maintenant ?
Avec les connaissances de Jean Paul Sebuhayi Uwase, architecte et directeur de la conception au sein du groupe MASS Design, les participant·e·s ont discuté en profondeur de ce que peut signifier servir une communauté.
L’atelier était accompagné par Jonathan Bongi et Jean Kamba.
Lubricate Coil Engine – Decolonial Supplication | Performance
 Lubricate Coil Engine — Decolonial Supplication (Moteur à Bobine Lubrifiant — Supplication Décoloniale) | Performance. Tabita Rézaire
Lubricate Coil Engine — Decolonial Supplication (Moteur à Bobine Lubrifiant — Supplication Décoloniale) | Performance. Tabita Rézaire
Lubricate Coil Engine de Tabita Rézaire était une supplication pour restaurer notre capacité à nous connecter. Selon ses propres mots : « Pendant que l’éternité se répète, nous défilons dans le vide pour échapper à nos conditions existentielles. Comment nous connectons-nous ? L’eau, la matrice, les plantes de rêve et le son, sont récupérés comme interfaces de connexion contre l’amnésie fabriquée. »
 Polyphonie Éducative et Espaces des Savoir(-Faire). Nioni Masela, Orakle Ngoy, Cedrick Nzolo, Eddy Ekete, Henri Kalama, Jean Kamba
Polyphonie Éducative et Espaces des Savoir(-Faire). Nioni Masela, Orakle Ngoy, Cedrick Nzolo, Eddy Ekete, Henri Kalama, Jean Kamba
Cette table ronde répondait au thème entrepris pour cette troisième journée de la conférence Polyphonie Éducative et Espaces des Savoir(-Faire) pour discuter les différentes formes et formats de l’éducation et des structures éducatives. Le directeur général de l’Académie des Beaux-Arts Kinshasa, Henri Kalama ; le designer et professeur à l’Institut National des Arts, Cedrick Nzolo ; la rappeuse et initiatrice de Afrika Diva, Orakle Ngoy ; et l’artiste et fondateur de Ndaku Ya La Vie Est Belle, Eddy Ekete ont présenté une variété de perspectives sur les structures d’enseignement institutionnalisées, ainsi que des environnements d’apprentissage autogérés.
Nioni Masela et Jean Kamba ont modéré cette table ronde.
 Corps Mêlés — Collisions Spatiales. Iviart Izamba, Jose Bamenikio, Grace Mujinga, Colette Poupie Onoya
Corps Mêlés — Collisions Spatiales. Iviart Izamba, Jose Bamenikio, Grace Mujinga, Colette Poupie Onoya
Cette table ronde répond au thème entrepris pour la quatrième journée de la conférence, Corps Mêlés — Collisions Spatiales, et parlera de l’espace qu’est la ville de Kinshasa — de son aspect architecturale et urbanistique, et de ses habitants, qui continuellement se confrontent à sa réalité et négocient avec elle. Les architectes, designers et éducateurs José Bamenikio, Iviart Izamba, Grace Mujinga et Colette Poupie Onoya ont élargi la compréhension des limites et des possibilités visibles et invisibles de la ville et du système éducatif pour le design.
Jean-Jacques Tankwey et Elsa Westreicher ont modéré cette table ronde.
 (non-)école d’été de design à S A V V Y Contemporary. Photo: S A V V Y Contemporary
(non-)école d’été de design à S A V V Y Contemporary. Photo: S A V V Y Contemporary
Pendant un mois, S A V V Y Contemporary s’est transformé en une « école » de design, que l’on pourrait aussi bien appeler une « non-école », en suivant les méandres entre modernité et colonialité, en s’interrogeant sur leurs répercussions sur le « faire-monde », ses schémas directeurs évidents et moins évidents. En explorant les méthodes et les pratiques en parallèle à ces discussions, quarante participant·e·s, cinq invité·e·s de Kinshasa, ainsi que les initiateurs d’ateliers ont progressivement donné forme à cet environnement d’apprentissage. Ensemble, des formes de co-vivre et de co-création ont été négociées, évoquant le racisme systémique, les privilèges blancs ancrés, les questions de confort et d’inconfort, d’oppression et de complicité, de résilience et de résistance.
 Design Without Planning: Everyday World-Building Outside The Gaze of Capital (Design sans Plan: Construction Quotidienne du Monde Hors du Regard du Capital). Arjun Appadurai
Design Without Planning: Everyday World-Building Outside The Gaze of Capital (Design sans Plan: Construction Quotidienne du Monde Hors du Regard du Capital). Arjun Appadurai
Dans son exposé Design Without Planning: Everyday World-Building Outside The Gaze of Capital (Design sans Plan: Construction Quotidienne du Monde Hors du Regard du Capital), Arjun Appadurai a exploré une forme de pédagogie du design ancrée dans les activités quotidiennes et intégrant une sensibilité au design de la vie quotidienne des communautés défavorisées. Il a suggéré que l’objet fondamental du design est la socialité elle-même, et non le monde des choses.
 Ziba, Toguna, Tree: Applications of Traditional Multi-Use Space-Making in Contemporary African Architecture (Ziba, Toguna, Arbre: L’application de Méthodes de Construction Traditionnelles d’Espaces à Usages Multiples dans l’Architecture Africaine Contemporaine). Olani Ewunnet
Ziba, Toguna, Tree: Applications of Traditional Multi-Use Space-Making in Contemporary African Architecture (Ziba, Toguna, Arbre: L’application de Méthodes de Construction Traditionnelles d’Espaces à Usages Multiples dans l’Architecture Africaine Contemporaine). Olani Ewunnet
Dans cet exposé, l’urbaniste, chercheuse et artiste Olani Ewunnet a examiné la capacité générative de l’objet, de l’espace et de la nature ou de ziba, toguna et arbre. Activant les archives couvrant 20 ans de projets de la Fondation Kéré / Kéré Architecture et s’inspirant de la riche tradition de la construction collective dans le Burkina Faso central, Ewunnet a exploré les façons dont l’architecture africaine contemporaine peut améliorer le bien-être des communautés, des environnements et des économies locales.
 lecture-performance au Bauhaus-Archiv — Museum für Gestaltung Berlin. Bauhaus-Archiv – Museum für Gestaltung Berlin
lecture-performance au Bauhaus-Archiv — Museum für Gestaltung Berlin. Bauhaus-Archiv – Museum für Gestaltung Berlin
Sur invitation du Bauhaus-Archiv — Museum für Gestaltung Berlin, S A V V Y Contemporary et les participant·e·s du chapitre berlinois de Triangles Tournoyants ont occupé cet espace pour donner une lecture-performance aux multiples têtes et mains, dans laquelle les pratiques et les questions de la « non-école » sont devenues un vécu pour le public en dehors de S A V V Y Contemporary.
 Comfort / Discomfort Workshop. Jean-Jacques Tankwey and Lema Diandandila
Comfort / Discomfort Workshop. Jean-Jacques Tankwey and Lema Diandandila
Cet atelier est parti du constat qu’en tant que designers, nous nous préoccupons souvent de concevoir pour d’autres, en supposant que nous connaissons leur confort et à quoi celui-ci ressemble. Jean-Jacques Tankwey et Lema Diandandila ont proposé de remettre en question cette idée.
 Les Façades Comme Espaces de Communication et Espaces Intimes pour des Corps Résonnants. Grace Mujinga, Orakle Ngoy, Nada Tshibwabwa
Les Façades Comme Espaces de Communication et Espaces Intimes pour des Corps Résonnants. Grace Mujinga, Orakle Ngoy, Nada Tshibwabwa
Cet atelier a proposé le rituel comme forme d’éducation à partir de l’exemple des villages Makwacha dans la région du Katanga en R. D. Congo. Dans ce village de femmes, le rituel, consistant à peindre les murs des bâtiments, fait partie d’un processus d’apprentissage intergénérationnel. À partir de là, les participant·e·s ont interrogé les façades comme espaces de transmission et de traduction ; entre le caché et le révélé, entre un intérieur et un extérieur, entre le monde matériel et immatériel. L’atelier a été initié par l’architecte Grace Mujinga, la rappeuse Orakle Ngoy et l’artiste / musicien Nada Tshibwabwa.
 conférence internationale annuelle de Para Site. Andreas Siagian, Clara Lobregat Balaguer, Lawrence Chua, Katerina Teaiwa, Ema Tavola, Iliana Fokianaki, Christian Nyampeta, Sebastian Cichocki, Simon Soon, Lupe Fiasco, Sugata Ray, Tan Zi Hao, Lesley Ma, Cosmin Costinas, Anqi Li
conférence internationale annuelle de Para Site. Andreas Siagian, Clara Lobregat Balaguer, Lawrence Chua, Katerina Teaiwa, Ema Tavola, Iliana Fokianaki, Christian Nyampeta, Sebastian Cichocki, Simon Soon, Lupe Fiasco, Sugata Ray, Tan Zi Hao, Lesley Ma, Cosmin Costinas, Anqi Li
Para Site était le partenaire pour Triangles Tournoyants à Hong Kong. En tant que première institution d’art contemporain de Hong Kong à organiser des expositions, et en tant que structure auto-organisée cruciale au sein de la société civile de la ville, Para Site a su ouvrir d’avantage les conversations au sein de Triangles Tournoyants. La conférence internationale ainsi que les ateliers qui l’accompagnaient ont plutôt cherché à examiner « une cartographie et une généalogie étendues de résistance par le biais du design, de l’éducation et de la dés-éduaction, des échanges et des circulations de formes dans des mondes visuels qui ont eu d’autres directions de circulation et ont créé une compréhension différente de ce à quoi pourrait ressembler un langage internationaliste »[2] qu’à centrer l’héritage du Bauhaus.
[2] Concept de Para Site pour la conférence internationale 2019.
 Ateliers pour Professionnels Émergents de l’Art. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung
Ateliers pour Professionnels Émergents de l’Art. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung
Depuis cinq ans, Para Site, l’une des plus anciennes institutions culturelles indépendantes de Hong Kong, se concentrant sur les pratiques artistiques contemporaines, organise des ateliers pour les conservateurs, écrivains, critiques, chercheurs et autres professionnels émergents de l’art de Hong Kong et de l’étranger. À travers une série d’ateliers, de conférences et de visites de sites, ce programme intensif de 9 jours offre des possibilités d’apprentissage et de réflexion, grâce à la médiation d’orateurs réputés de la conférence internationale de Para Site ainsi que de praticiens de l’art provenant de l’ensemble du paysage institutionnel diversifié de Hong Kong.
 Un centre d’apprentissage et de communauté en construction à Sangwoodgoon, une ferme biologique collective à Hong Kong. Lo Lai Lai
Un centre d’apprentissage et de communauté en construction à Sangwoodgoon, une ferme biologique collective à Hong Kong. Lo Lai Lai
Lors des ateliers pour les professionnels émergents, organisés par Para Site, de nombreuses visites ont été programmées. Parmi elles, une initiative d’agriculture collective, Sangwoodgoon. L’artiste Lo Lai Lai, elle-même apprenante dans le cadre de cette initiative, nous a expliqué et montré les enchevêtrements sociaux, naturels et politiques complexes à l’œuvre au sein de la structure.
 Berlin publication. Summer (Un-)School of Design at S A V V Y Contemporary
Berlin publication. Summer (Un-)School of Design at S A V V Y Contemporary
Au cours du chapitre berlinois de Triangles Tournoyants, les participant·e·s ont créé collectivement une publication. Des pages libres, créées par les personnes impliquées dans la « non-école », se sont rassemblées sous forme de fragments flottants, se connectant et se déconnectant les uns des autres, se mêlant et créant un rythme entre les voix visuelles et écrites. Les noms et les titres des contributions ont été imprimés mais n’ont pas été assignés directement aux travaux, ce qui a permis l’apparition d’une deuxième couche, ne donnant pas de réponses directes mais plutôt des indices, compliquant notre désir d'assigner un sens direct à ce qui nous entoure.
Alejandra Alvarez (Learning Devices), Jasmina Al-Qaisi & Clara Saez (Grandma Knowledge is Science), Andrea Anzala & Frida Robles (How Insistent Are Our Urban Ghosts?), Banka; Jonathan Bongi, Jean Kamba, Rita Mayala, Elie Mbansing, Jean-Jacques Tankwey (Kinshasa Mboka Banka), Elia Diane Fushi Bekene (Who?), Katharina Birkmann & Marlene Kargl (Healing Landscapes), Clara Brandt & Emilia Escobar & Noara Quintana (Mouth, Hands, Spirit – No Head), Khaleb Brooks (On the Subject of Blackness and Technologies of Power), Maria Camilo (Flood), Uğur Latif Çelebi (Eternal Eyes And The Power Of Images), Juliette Dana (Can You Pour Water in my Cup? I've Been Taping The Cracks ), Lema Diandandila (Lisanga Bakoko Souhaite Partager Les Savoirs Avec Tout Le Monde. Si Un Ancêtre Meurt Sans Le Partager C’est Toute Une Bibliotheque Qui Meurt), Emilia Escobar (Must it Always Be Grids?), Uğur Latif Çelebi & Juliette Dana & Michalis Fountedakis & Olga Konik & Franca López Barbera & Antonio Mendes & Fanny Souade Sow (Juxtaposition), Gabe Gordon (Inter-Non-National Citizen Stamp Advisory Committee Issue One, Or, What Is Lick-able And Who Is Free, Or, Who Is Lick-able And What Is Free?), Samira Hodaei (From Object To Storytelling), Valerie Kong (10 Things About Eating), Olga Konik (What Is Your Food Landscape?), Lia Krucken (Our Body Writes), Galina Kruzhilina (List), Eliza Levinson (Das Wasser Zwischen Dir und Mir), Thomas Lindenberg & Shreyasi Pathak (Steal, Steel And More Steal), Franca López Barbera & Patricia Sayuri (When The Tide Rises), George Lynch (As A Shaken Can), Grace Mujinga (Construire A Moindre Coût Avec Les Matériaux Locaux, Isolation Thermique Et Acoustique Sont Garantis Et Une Bonne Ventilation Assurée), Osman Mukhtar (Have Never Been, It Just Seems, I Stick in Between), Orakle Ngoy (Du Sens Au Sens), Garth Roberts (9/10ths), Eeva Rönkä (Compose), Patricia Sayuri (Casinha), Mariama Sow & Dior Thiam (Mandombe Als Dekoloniale Strategie), Jean Jacques Tankwey (Confort-Inconfort, Décoder!), Nada Tshibwabwa (Bozui Tozali Komona Eza Malamu. Kasi Ezali Ya Molili To Ya Malamu? / Les Biens Matériels, C’est Bien. Mais Est-Ce Qu’ils Sont Vraiment Matériels Ou Ce L’Au-delà? / Material Goods Are Fine. But Are They Really Material Or From Beyond?).
Les participant·e·s formant l’équipe de rédaction étaient : George Lynch, Franca López Barbera, Eloise Maltby Maland (éditeurs). Jasmina Al-Qaisi, Andréa Anzala, Michalis Fountedakis, Olga Konik, Galina Kruzhilina, Eliza Levinson, Osman Mukhtar, Caroline Neumann, Garth Roberts, Frida Robles, Clara Saez.
La publication a été imprimée par WeMakeIt (Berlin).